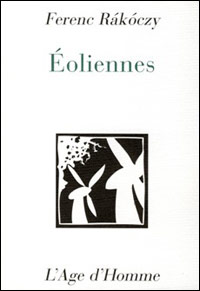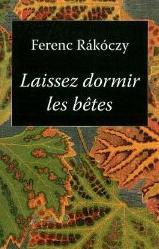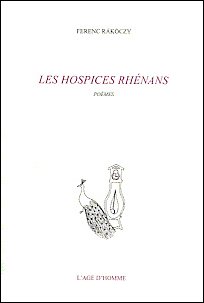mercredi, 31 octobre 2012
Jeux avec la vouivre
Lorsque je passe près d’un cours d’eau, quelle qu’en soit l’importance sur la carte ou dans les mémoires, je ne puis m’empêcher de m’arrêter. Mon idéal se contente d’un de ces filets d’azur qui font des serpentements sans fin dans une plaine dégagée, car je sais qu’ils finissent toujours par embrasser, au bout de la ligne d’horizon, entre le ciel et l’herbe opulente, l’infini. Question de temps et de patience, sans doute. Je suis là, au milieu de nulle part. Un glougloutement moussu frange les bords du courant d’une fine et tendre dentelle. Il pleut bas sur la sauge, le pissenlit, la sarriette. Mais la pluie elle-même efface peu à peu ce sensible tableau, sculptant par tourbillons un paysage vertical où l’eau se mêle à la bourrasque et la bourrasque au temps. De sorte que l’attente elle-même y prend un tour merveilleux où dominent les feux de l'imagination.
Ces lieux sont magiques, on ne le dira jamais assez. On y rencontre quelquefois des créatures extravagantes et – le plus souvent – bénéfiques, lorsqu’elles n’exhalent pas la tristesse ou la volupté. Depuis qu’il y a des hommes qui rêvent et savent rêver, elles se tiennent pour eux aux confins des mondes déferlants, et attendent, attendent...
Oui, qu’attendent-elles au fait ?
On n’en sait…rien, ou presque – heureusement!
Elles sommeillent sur des trésors, vivent enfouies dans les marais ou dans la proximité de sources qui leur permettent, par des voies secrètes, de rejoindre le centre de la terre par leurs prières et leurs sortilèges. Aveugles, elles s’orientent grâce à une escarboucle dont elles dépendent entièrement. Tantôt femme, tantôt oiseau-serpent, elles volent en faisant gicler autour d’elles un éventail de gouttes lumineuses qu’on prend quelquefois pour l’arc-en-ciel, un croissant de lune ou encore un cercle d’étoiles, tant cela change et change à n'en plus finir; on les voit alors qui s’élèvent d’un battement d’ailes vif et cependant mesuré au-dessus des collines, des hameaux.
Ma vouivre à moi (puisque tel est le nom que je lui donne) se manifeste quand souffle le vent du nord et que flotte la bruine au-dessus des pâturages. Je la remarque de loin – un petit sifflement m’avertit de sa présence, vu qu’elle me fait la politesse de s’annoncer; peu à peu ce sifflement inaugural se transforme en modulations, en nappes sonores qui enveloppent tout, êtres animés et minéraux, d’un halo paisible. Avec ce chant d’une douceur infinie, elle est l’incarnation de l'esprit musical.
Aussitôt apparue, aussitôt envolée.
On va guigner derrière un cabanon abandonné: rien. On cherche à l’apercevoir entre les saules, derrière les étables vides sentant la paille: toujours rien. Et voilà que, pour quelque raison bizarre, elle apparaît soudain à un demi-jet de pierre, si près qu’il suffirait presque d’étendre la main pour la toucher (mais on s’en gardera bien, car on a été averti – elle est capable de nager, ramper, voler jusque dans le soleil, et quand sa fureur s’éveille, mieux vaut avoir pris la poudre d’escampette).
Elle perpétue en manière de salut les éclairs et la pluie dans la pénombre des tilleuls, avant de s’inviter pour le casse-croûte (j’ai ma gibecière). Après m’être assis à ses pieds, je lui offre un peu de pain doré et de ce fromage terrible qui la met toujours en émoi. Je sens qu’elle appréhende – oh! sans s’appesantir trop, car les soucis la font changer de couleur, et c’est à chaque fois une petite catastrophe – nos réunions, qu’elle doit juger, ma foi, bien étranges, bien étranges.
Ces moments sont surtout des moments de connaissance où s’ouvre tout à coup une brèche, où mon existence en vase clos s’emplit d’une eau plus lumineuse, d’un aflux d’espérance. Elle vient toujours à point pour me guérir de quelque tourment, le plus souvent après la visite de l’une ou l’autre de mes anciennes maîtresses, que je préfère ne pas nommer ici. Au regard de ces dernières, extraordinaire est son calme, sa pondération!
Pourtant, je ne la suppose pas dénuée d’humour ni d’une certaine perfidie, perfidie d’ailleurs nécessaire lorsque les humains s’en prennent à son escarboucle et que l’herbe folle ne lui offre plus d'abri suffisant à leurs méchantes entreprises. Par exemple, jamais ne on verra un poète – même mineur – s’adonner à de telles vilénies! Cela, elle l’a bien compris et elle m’en sait gré.
Que dire de plus?
Qu’elle distrait de la mélancolie et des chagrins ordinaires de l’existence, ça, chacun l’aura deviné. Que sa compagnie ouvre le troisième œil, c’est ce que l’on ose à peine murmurer, et encore, en regardant avec effroi autour de soi. Aussi loin que portent mes souvenirs, elle a toujours veillé sur ma destinée. Il faut croire qu’elle accomplit cela avec beaucoup d’efficacité.
08:40 Publié dans Jeux avec la vouivre | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, poésie, poème, écriture
mercredi, 28 avril 2010
Laissez dormir les bêtes
 Chers amis des animaux et des lettres, une fois n'est pas coutume, voici l'annonce de publication pour mon dernier livre, au dos duquel on peut plus ou moins lire après avoir chaussé les lunettes d'usage:
Chers amis des animaux et des lettres, une fois n'est pas coutume, voici l'annonce de publication pour mon dernier livre, au dos duquel on peut plus ou moins lire après avoir chaussé les lunettes d'usage:
« Un homme attaché qui hallucine sur son lit, une cuisinière pleine de sollicitude pour les escargots, un orphelin métamorphosé en carpe, des gens du voyage parqués sur une décharge chimique, une jeune femme volontaire et sensuelle, mais qui ne s’accepte pas, un groupe d’artistes peintres dévoyés par leurs folles ambitions, qu’est-ce qui peut bien rassembler des destins à première vue si épars ? Peut-être le besoin de retrouver, en dépit du caractère fragmentaire de toute existence, un peu de fraternité, un idéal qui permette de se soutenir, mais aussi et surtout les voies de la vie secrète – rêves, fantasmes ou obsessions. Comment se reconstruire à partir de l’irréparable cassure ? Comment dormir quand on est condamné à perdre sans cesse ce qui nous importe le plus ?
C’est ces dilemmes que chacun des personnages qui hantent ces pages tente à sa façon de résoudre. Pour ces animaux ultrasophistiqués que nous sommes devenus, à des années-lumière les uns des autres, enfoncés dans la recherche d’une vérité inatteignable, quel espoir reste-t-il ? Loin de l’exhibitionnisme sordide, de l’impudeur ou de la dérision, ces six récits semblent avoir été conçus comme des romans miniatures et, à ce titre, ils expriment une certaine façon de se mouvoir au cœur du monde contemporain. Quoi qu’il en soit, les fictions flamboyantes de Ferenc Rákóczy, souvent drôles, toujours inspirées et aussi imprévisibles que l’être humain lui-même, nous infligent une profonde secousse morale tout en nous restituant notre part d’humanité. »
Laissez dormir les bêtes, récits, L'Age d'Homme, Lausanne, 2010
Lire un avis sur Critiques libres
Commander Laissez dormir les bêtes sur le site des éditions l'Age d'Homme
23:13 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
dimanche, 07 mars 2010
Simone Weil (1909-1943)
La pesanteur et la grâce
13:36 Publié dans Paroles ouvertes (citations I) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature
Comme une vie sous la langue
Lucien Noullez, après nous avoir surpris par des poèmes de plus en plus ténus, en suspension presque dans la perfection de leurs images, démontre avec la publication d’Une vie sous la langue (L’Âge d’Homme, 2009) que tout journal littéraire se met pour ainsi dire obligatoirement du côté du fragmentaire, de l’informe, de l’inachèvement, et que c’est bien ainsi qu’il parvient à nous offrir le meilleur de lui-même. Rappelons brièvement que Noullez, d’origine wallonne, est né à Bruxelles en 1957. Il est enseignant, poète et critique littéraire. Il a également donné un très beau récit mi-autobiographique, mi-romancé, L’érable au coeur (L’Âge d’Homme, 2009), racontant avec beaucoup de sensibilité et de vergogne tour à tour une enfance bruxelloise des années soixante et les incroyables aventures d’un jeune gendarme de la Grande Guerre, qui dut sa survie à l’amitié, à un cheval et à son amour pour le violon.
À mi-chemin entre celui de Julien Green (qui lui sert d’ailleurs de sésame et de pôle entraînant) et celui de Charles Juliet (pour le caractère immédiat du style), son journal littéraire a beau couvrir une période limitée (les années 2001 à 2002), il manifeste néanmoins une ouverture au monde exceptionnelle. Une prose drue, rythmée, parsemée de trouvailles poétiques en permanence justes, données (« recueillies »). Sans doute s'agit-il d'une « simple attention aux minuscules dissidences de l'instant », mais n'est-ce pas là que se révèlent les choses cachées, que s'approfondit le mystère de l'existant? Rien de moins guindé, rien de plus instructif que ces pages pour entrer dans l’intimité de son auteur, et on le suit avec délectation dans ses voyages, son quotidien, ses réflexions autour de la marche des choses, de la bible ou encore de la musique, omniprésente dans sa vie.
Car c’est en effet la merveilleuse musique qui sert de fil conducteur au diariste : on la sent douce, spirituelle, toujours très agissante, porteuse des mêmes pouvoirs consolateurs que la poésie en somme (« La musique élargit la prairie. »). Un tremplin pour sauter au cœur de l’art (entendu que tout le cosmos est appelé à devenir art), pour faire revivre une seconde fois le quotidien à travers les mots. En même temps, Noullez – qui est la modestie même – conçoit la tenue du journal comme l’exploration d’un genre littéraire à part entière, éclairé par la foi, à telle enseigne qu’il en devient un filtre et un fabuleux tamis du temps, l'oeil de la mémoire qui est là, qui veille et comprend. Les passages sur les enfants de la rue sont poignants, ils apparaissent comme un rappel à l'ordre, une injonction à agir. C’est parce qu’il est si proche de la vie et des êtres (même les plus démunis) qu’on sent se développer une fraternité, un incommensurable élan vers cette nouvelle définition de la sensibilité.
Lucien Noullez, Une vie sous la langue, éditions L'Age d'Homme, Lausanne 2009
11:03 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
samedi, 30 janvier 2010
Ce qui se trouve au fond du sac
Ecrivain tessinois de gauche, Plinio Martini (1923-1979) est de ceux qui, en publiant, ont tout engagé d'eux-mêmes : leur vie, leur enfance, leur vision du monde, et jusqu'à cette musique intime qu'on entend résonner comme une harpe éolienne au creux des vallons d'ombre de son pays. Il s'est ainsi créé une forme détournée de mystique qui transparaît tant dans dans ses romans que dans ses nouvelles, et les anime discrètement d'une vertu singulière, en quoi il dépasse la simple chronique sociale et politique - même si c'est une des lectures qu'on peut en faire. Quoi qu'il en soit, Le fond du sac (1970) apparaît comme le livre de la maturité et du souvenir, situé à l'opposé de toute littérature de confort, et à ce titre il se dessine comme un document sur le dénuement et la misère qui régnaient dans les vallées tessinoises encore jusqu'aux alentours de l'entre-deux guerres. A l'envers de toute idylle alpestre, il n'est guère de récit qui soit moins composé, écrit davantage d'inspiration.
Le fond du sac est avant tout la restitution fidèle d'un trajet de vie. Revenu au pays après un éloignement de dix-sept ans, Gori Valdi, le narrateur, se veut le témoin de la vérité, seule capable de le sauver de l'échec existentiel. Il va son chemin, se heurte, trébuche, s'obstine. Faisant son possible pour mieux comprendre ce qui lui est arrivé, il s'exprime dans un langage rude et dénué d'artifices : répétitions voulues, tournures populaires chargées de mots dialectaux, maladresses de la parole, hésitante et partagée. La bouche obéit mal lorsque le cœur murmure. Le personnage central s'adresse à un proche jamais nommé, un tu qui met le lecteur de plain-pied avec la réalité des faits, leurs causes et leurs répercussions. C'est donc avec violence qu'on est immergé dans le petit village de Cavergno, aux confins du val Maggia, où l'auteur et le narrateur ont tous deux grandi. A cette époque, le Tessin sommeillait depuis quelques siècles dans une pauvreté silencieuse. Pays de pierres, de solitude, de précipices, une peur sans nom et sans fin habite le cœur de ses enfants. On sent, douloureuse, immédiate, la présence de la misère, cette misère qui écrase irrémédiablement toute destinée sous le poids des maladies, de la famine, des sordides accidents de montagne. Toute activité, toute fièvre n'est bonne qu'à ça : survivre. On comprend que l'émigration se dessine alors comme une échappatoire, un mince espoir de salut.
Le pauvre Gori est englué sans merci dans ce mauvais sort ; après tout, son grand-père Venanzio n'avait-il pas déjà fait son balluchon à quatorze ans pour aborder sur les rivages d'une Corse tout sauf douce, où il exerça le métier de maçon ? Dans ce contexte, même s'il est amoureux de la charmante Madeleine, l'Amérique représente, peut-être, une petite lueur d'espoir. Plinio Martini a construit son récit autour de ce noeud gordien: la tension qu'il peut y avoir entre la nécessité de partir et la naissance du sentiment amoureux. Par un de ces paradoxes à la fois cruels et chers à l'auteur, la tentative de Gori pour échapper au désespoir par l'exil sera à l'origine de la disparition de Madeleine, la fiancée, l'unique amour, l'étoile suspendue à son ciel de chevrier. C'est par orgueil qu'il a voulu s'expatrier en Californie avec son frère Antonio, quitter la communauté, sortir du rang. Il pensait seul en payer le prix. Il lui faut Madeleine pour vivre, mais Madeleine sera bientôt, comme le reste, anéantie. En toute bonne logique, pourrait-on dire, c'est sa loyauté, son statut d'orpheline et son inscription dans une nouvelle filiation (elle contracte la pneumonie en rendant visite à sa future belle-mère) qui seront cause de sa mort. Ainsi fatalité intérieure et extérieure se conjuguent pour mieux briser les êtres au plus intime de leur ressort. Nul salut, nul apaisement. Pourquoi en va-t-il ainsi ? C'est la question que le narrateur se pose tout au long du récit. Le visage humain peut disparaître, tomber en poudre. Même les liens de l'affection semblent incapables de le protéger de son malheur, lorsqu'ils ne précipitent pas sa perte. Il y a là une manifestation d'un drame plus ample, pour ainsi dire cosmique, par lequel Madeleine devient victime expiatoire et signe de l'impuissance de la tribu face à une nature sauvage qui redemande périodiquement des innocents à dévorer.
Il n'est pas facile de résumer en quelques lignes les vibrations qui traversent ce roman. Presque tous les héros qu'on rencontre dans Le Fond du sac restent prisonniers du temps qui passe, ou du temps passé. De là vient une part de leur grandeur, mais pas la seule. A l'instar de Don Giuseppe, prédicateur d'une religion suffocante, dont le plus grand souci est de sauver les âmes qui lui ont été confiées (s'il ne se donne entier, il ne donne rien), Gori trouve sa rédemption dans le feu de la parole, cette flamme qui, soudain, éclaire tout, comme une lampe de ses rayons horizontaux. A la tradition et à l'ordre de l'Eglise, il oppose la parole de celui qui, littéralement, languit après les siens, que la pauvreté et une morale rigide éloignent autant que l'exil. Au cœur de l'attention que nous portons aux êtres se tient l'absence. Et c'est en prenant la mesure de cette absence que le narrateur parvient, par la conscience de l'inanité de toute chose, à réconcilier le dire et l'être, l'universel et le singulier, et à ainsi faire entrer le grand monde dans le petit monde de son canton, avec ses expériences, ses tribulations, la fascination que nécessairement il exerce. Ce qu'il cherchait était là, tout près, à portée de main.
L'Amérique de Gori, où il s'est enrichi pourtant, n'a pas rempli ses promesses. Il n'en revient pas les mains vides, mais ce qu'il a involontairement perdu, le coeur, un certain sentiment lié à sa jeunesse, son innocence, tout cela ne se retrouvera plus. Sans l'amour, il n'y a plus qu'amertume au fond du sac qui se noue sur les illusions d'une vie ouverte au bonheur, à la joie simple de fonder un foyer, de perpétuer la lignée ancestrale. Comment accepter de cheminer sans espoir, coupable et condamné ? L'impossible est consubstantiel au réel. C'est toute la thématique du devenir adulte, du deuil de l'enfance et de la douleur que cela comporte. Restent la lutte et cette étonnante lucidité qui vient de l'auteur, sans doute, tout en relevant profondément du personnage : une forme de sollicitude dans l'affliction, une voix qui reste et s'imprime, unique, dans la mémoire des hommes.
Le fond du sac, Plinio Martini, traduit par Jeanine Gehring, Poche suisse 69, éditions L'Âge d'Homme, Lausanne, 1990.
Article remis à jour en janvier 2010
18:50 Publié dans Plinio Martini | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
samedi, 26 décembre 2009
Pasolini en hiver
Des restes de neige dans les arbres et les champs, entre les joncs dont la houpette s'agite doucement, comme si une très ancienne mémoire avait déposé sa patine sur ces êtres immémoriaux. Je promène le chien qui sautille avec de petits bonds précautionneux d'une motte à l'autre, évitant les flaques gelées, les méandres du ruisseauxdont un filet d'argent scintillant continue de gargouiller dans le silence de la campagne. Le froid pourtant semble avoir interrompu toute vie autour de nous. Puis je rentre, m'assieds derrière mon bureau, c'est le meilleur moment de la journée. De l'autre côté de la fenêtre, un ciel presque cinématographique déploie ses mauves et ors au-dessus de la ligne des peupliers nus et frémissants. Un peu de la calorie du sud débordant dans le grand nord.
Cela me rappelle que ces temps-ci, sous prétexte de me réchauffer le cœur, un ami me projette soir après soir les films de Pier Paolo Pasolini, choisissant parmi ceux qu'il admire le plus. Des images d'une magie irréprochable et d'une lucidité effrayante, qui tantôt transportent, tantôt glacent le sang, parce qu'elles nous montrent, au travers de symboles solaires, telluriques, primitifs, le tréfonds de l'âme (un terme que le cinéaste communiste récuserait à bon droit). Malgré un hédonisme affiché, malgré la provocation de qui veut mettre à mal le bourgeois, il s'agit avant tout, dans cette oeuvre sans vergogne, de percer les hauts murs du destin. Ici, les lignes d'intensité sont des cercles d'enfermement sur lesquels nous errons, à la remorque d'un héros d'épopée hors temps, dans un pur espace imaginaire.
Mais Pasolini, qui était-il au fait ? Voici une question à laquelle il est bien difficile de répondre... Le savait-il lui-même? Une piste cependant: sa mort misérable, déjà toute entière contenue dans certains plans qu'on pourrait presque dire fixes et, néanmoins, totalement hallucinatoires. Il précède toujours d'une bonne longueur l'art de son temps. Il précède son avenir. Type du créateur hanté par ses obsessions, voilà que le monde s'en mêle aussi et se referme sur lui. En tant que poète également, qui pourrait, aujourd'hui, lui être comparé dans le domaine de la sensibilité? Il y a en France, par exemple, une manifeste volonté de produire de la culture écrite en tant que telle, mais cette culture demeure essentiellement vide, parce que c'est une production de contenus faux, pur effort de réflexion sur une pratique qui n'existe pas et sans liens significatifs avec le réel. À l'opposé, les richesses d'échanges entre cinéma et fiction romanesque, tant aux Etats-Unis qu'en Italie, auront permis d'exprimer la spécificité d'un langage qui privilégie le sujet original, la recherche de la vérité, la circulation des idées et des hommes.
19:06 Publié dans Journal de peu (extraits) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, cinéma
mardi, 10 novembre 2009
Proverbe arabe
« On est maître de son silence et esclave de ses paroles. »
22:33 Publié dans Proverbes et sornettes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, proverbe
jeudi, 29 octobre 2009
Albert Einstein (1879-1955)
« Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons crée une société qui honore le serviteur et a oublié le don. »
Comment je vois le monde, Flammarion, 1935
23:05 Publié dans Perles noires (citations II) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philsosphie
jeudi, 08 octobre 2009
Raymond Abellio (1907-1986)
« Il ne faut craindre ni l'amour, ni l'absence d'amour. Que chacun vive selon sa nature et sa place, et comble sa mesure de vie. Et rien ne sera accompli tant que la mesure ne sera pas comble, dans l'homme et dans le temps. »
Les Yeux d'Ézéchiel sont ouverts, Gallimard, 1949
00:44 Publié dans Paroles ouvertes (citations I) | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature
samedi, 19 septembre 2009
Charles-Albert Cingria (1883-1954)
« J'ai une grande confiance dans la santé poétique des masses vraiment masses. »
Auteurs, éditeurs et... lecteurs
18:08 Publié dans Proverbes et sornettes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, citations
dimanche, 30 août 2009
Un Cassandre post-atomique
On ne sait plus très bien où est le nucléaire, proclamait
Onésime Duvivier à qui voulait l’entendre (si, partout). À force,
Il nous portait sur les nerfs, c’est vrai, avec ses spectres
Qui avaient pour noms : cancers thyroïdiens, leucémies
Et moult horreurs prenant corps dans le génome humain.
Oui, un cycle s’achève, une conscience furtivement s’éveille.
Ainsi, le moment venu, chacun sera-t-il prêt au grand plongeon
Dans un monde où la singularité brille comme un signe de l’universel.
Avec sa barbe de hippie passionné, il imprimait
Dans nos cervelles ces proliférations monstrueuses,
Ce partout terrifiant (sans compter les crépuscules lavés de pluies
Acides, les eaux usées, les baleines, le réchauffement
Climatique). Il est si difficile déjà d’avoir sa tranche d’air.
De ce propos-ci à ce propos-là, nous n’en finissions
Pas de nous colleter avec une nature sans fond ni bords
Témoins enfantins de sa rage, impuissants comme lui :
Rien que d’y penser, j’en frissonne encore.
Extrait d'Éoliennes, L'Age d'Homme, 2007
05:52 Publié dans Éoliennes, quelques courants d'air | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, littérature
vendredi, 26 juin 2009
Roland Donzé ou le temps de l’innocence
Écrivain suisse d’expression française, Roland Donzé fête ces jours-ci ses quatre-vingt-huit ans. Rappelons qu’avant de se lancer dans la fiction, il a occupé les fonctions de professeur ordinaire de philologie française à l’Université de Berne et est considéré comme une référence internationale dans ce domaine. Son extraordinaire Saga biennoise, composée à partir des années quatre-vingt, retrace, sur trois générations, les tribulations de deux familles liées par les liens du mariage, tribulations vues à travers les yeux du narrateur, Serge, qui décède avec son épouse dans un crash aérien au début du dernier opus, obligeant dès lors l’histoire à continuer sans lui. Donzé s’est vu attribuer en 2005 le Prix de la ville de Bienne pour l’ensemble de son œuvre, parue aux Éditions l’Âge d’Homme, de 1985 à 2006. L’été dernier, il a déposé le tapuscrit de ses cinq romans (retravaillés chacun jusqu’à une bonne dizaine de fois), sa correspondance ainsi que plusieurs documents annexes aux Archives littéraires de la Bibliothèque nationale. Cela fait de lui le seul écrivain vivant qui n'ait pas d'oeuvre à achever, sur qui l'on ne puisse se sentir de droits...
Pour ma part, je suis très fier d’avoir été l’un des premiers à lire en public ses romans qui, tant en Ajoie, qu'à Bienne ou à Lausanne, ont toujours rencontré une oreille enthousiaste et suscité une très vive émotion. Chopique, son second livre, me semble une chose immense, établie, précise et pourtant révélatrice et éclairante, et que je mets personnellement à côté des plus grandes que je connaisse. Il y a vraiment beaucoup d’arguments pour considérer la Saga biennoise comme un classique moderne des lettres romandes, et son auteur comme l’un des plus importants de ce pays, pourtant peu avare en talents, mais si long à leur accorder une vraie reconnaissance. D’abord par les sujets abordés : l’enfance, la pauvreté urbaine, la judaïté, la fragilité de la jeunesse, l’amour incestueux, la disparition de la mère tant aimée, la lutte et l’élévation sociale ou encore l’accès à l’écriture. Ensuite, par la technique narrative, profondément originale, à la fois épique et pudique, violente et musicale, si frappante que le lecteur en sera d’emblée déconcerté, bouleversé dans ses habitudes les mieux établies.
On peut affirmer sans exagérer que Donzé réinvente le dialogue et le monologue intérieur, faisant progresser son récit d’un pas très sûr, très vif, jusqu’au but qu’il s’est assigné : l’idée d’une certaine perfection formelle. Il sait comme nul autre capter l’énergie syncopée de la rue, la brillance d’un salon bourgeois, le conciliabule entre deux clochards célestes, les affrontements de l’adolescence. Cela s’effectue avec un raffinement rare et sensuel, car il n’y a qu’à travers la littérature qu’on entre au paradis. Dès la première phrase d’Une mesure pour rien, on est frappé par le rythme et cette scansion extraordinaire du texte, sa pulsation, cette marche un peu incertaine qui va toujours selon les accidents du temps – c’est à ce premier chapitre (Jeudi noir) que s’adosse toute l’œuvre à venir. On ne peut qu’admirer l’attaque et la chute des phrases, entrecoupées de silences, de non-dits, d’étourdissantes ellipses. Donzé a inventé un nouveau parler, l’acheminant vers ce point où il défaille et devient un chant, un miroitement, un simple relais à toutes les paroles au travail dans le monde.
Par ailleurs, l’écrivain, qui a pour ainsi dire tout lu, a conçu des personnages absolument hors du commun, souvent symétriques, ou alors incontestablement asymétriques, c’est selon: voix entremêlées, coupées, indissociables des bruits du temps ; ils heurtent de plein fouet l’imaginaire et demeurent longtemps dans la mémoire du lecteur qui doit accepter de se laisser toucher par cette prose hors des sentiers battus, pleine de fraîcheur et de tendresse amusée. Roland Donzé, qui se veut l’héritier direct des prodigieux conteurs – ouvriers, chômeurs, déclassés de toute espèce – qu’il a côtoyés dans les années vingt, à une époque où les enfants restaient encore bien sagement à table pour écouter parler les adultes, nous enchante en permanence, à chaque détour de page, par l’innocence sans apprêt de ses personnages, leurs côtés quelque peu désuets, mais toujours vrais, truculents, insolites, torturés, voire carrément intraitables. Il brosse ainsi le portrait d’une époque, mais surtout d’un tempérament, d’un air bien particulier, lié à un milieu typiquement helvétique (et donc juif, américain, international avant l’heure), ce qui nous semble, à nous, à la fois hautement instructif et parfaitement savoureux.
À ce titre, il possède à un degré de raffinement élevé l’art de faire jaillir le mouvement, la couleur, occasionnellement la beauté d’une situation simple au départ; oui, on peut dire qu’il ne suit jamais un tracé à l’avance, mais emprunte tous les sentiers de traverse que lui propose sa passion pour les belles constructions romanesques. Lire un livre de Roland Donzé, c’est s’offrir un rare instant de bonheur, être parachuté dans un univers où la moindre souris traversant un couloir prend une intensité, une présence telles qu’on l’entend trottiner pour de vrai. Roland Donzé parvient ainsi à recréer quelques éclats de cette grâce élémentaire que, parfois, on pourrait croire perdue. Voilà donc, n’en doutons pas, une œuvre riche de sève, mystérieuse, mystique presque, dont la force opère comme une délivrance, et en même temps une oeuvre miraculeusement préservée du moindre soupçon de prétention, et donc une œuvre pour notre temps et sans doute pour tous les temps.
La Saga biennoise aux Éditions L’Âge d’Homme :
Une mesure pour rien, 1985 (Poche suisse, 1999)
Chopique, 1990
Le temps du refus, 1995
Déborah, 1999
L’Impromptu de Boston, 2006
15:47 Publié dans Roland Donzé ou l'inncocence assumée | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, roman, critique
vendredi, 05 juin 2009
Blogème LXXXVII
Laisse parler tes instincts, aussi absurdes puissent-ils paraître à première vue. Inutile d’en tempérer leur caractère aveugle et irréfléchi, le tremblement de certitude qui semble les animer. Du reste, c’est seulement lorsque tu les auras vraiment admis comme tels, avec leur bassesse et leur incomparable vulgarité, avec leur dose d’abrutissement, leur tristesse, leur désespérante monotonie, qu’il leur arrivera de relâcher un peu leur emprise sur ta volonté.
22:57 Publié dans Blogèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie, aphorisme
samedi, 11 avril 2009
Blogème LXXXVI
Sans la clairvoyance du sage, impossible de rien connaître du monde. Sans l'obscurcissement du fou, impossible de tout connaître du monde.
08:53 Publié dans Blogèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, livre, poésie, aphorisme
mardi, 10 mars 2009
Blogème LXXXV
Chéris la nuit. Elle t'apprendra tout ce qu'il faut savoir.
21:32 Publié dans Blogèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie, aphorismes, pensées
mercredi, 25 février 2009
La Librairie-Papeterie Espace Le Pays de Porrentruy en danger
Qu'est-ce qu'une librairie sinon un espace privilégié où l'être de la liberté trouve à s'exprimer d'une façon unique et personnalisée dans notre société de plus en plus tournée vers le vulgaire, la rapidité, l'absence de liens?
Depuis la fin de l'année passée, celle de Porrentruy, qui est pour ainsi dire une rescapée de son espèce en Ajoie (Jura Suisse), se trouve gravement menacée de disparaître, comme tant d'autres. C'est à la fois une terrible nouvelle et une bien belle histoire, puisque le sauvetage a été décrété et rondement pris en main par la fille de Monsieur André Lièvre, le libraire en titre.
Cette dernière a donc lancé une action auprès des amis et de son réseau personnel, et il semblerait bien qu'elle ait réussi à susciter une mobilisation suffisamment large pour que la récolte de fonds aille bon train.
Tout ceci n'aurait sans doute pas été possible sans l'attachement que l'ensemble des Ajoulots ont pour leur libraire, pour son savoir-faire, sa générosité et son humansme, sa vaste connaissance de nombreux champs de la littérature d'hier et d'aujourd'hui.
Jamais avare d'un bon conseil de lecture, il a toujours un sourire et un gentil mot pour chacun, malgré les épreuves de la vie, de sorte qu'avec son enseigne, c'est un peu de son âme que l'Ajoie perdrait avant tout.
Espérons que cette catastrophe n'arrive jamais!
20:54 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : librairie, livre, littérature
vendredi, 20 février 2009
Mon frère et moi
J'ai grandi aux abords d’une rivière, près d’une cascade où les truites arc-en-ciel venaient nous danser avant l’orage leur ballet des origines ! Dès l’âge de huit, neuf, dix ans, j’ai passé le printemps, l’été, toute une partie de l’automne au bord de l’eau coureuse. Toutefois, en dépit d’un émerveillement constant, ma curiosité n’a pas véritablement su s’éveiller à la pêche. Une certaine maladresse dans le geste m’en éloigna sans doute. Et puis, il y avait mon frère Joseph, surtout, qui y excellait avec une habileté que lui enviaient les pêcheurs confirmés. Ceux-là le suivaient en douce ou cherchaient à se lier d’amitié avec lui dans l’espoir d’éventer ses secrets. Quant aux autres, les pêcheurs du dimanche, les stationneurs au petit pied, ceux dont nous disions qu’ils n’eussent pas trouvé de frites dans l’huile, ils l’épiaient derrière les croisées, la mine déconfite, lorsqu’il traversait nonchalamment le village, canne en main, sac en bandoulière, sans se douter le moins du monde de la provocation que constitue en soi une musette emplie de bêtes visqueuses et froides arrachées d’un geste précis au bouillonnement moussu d‘un rapide ou d’une chute (et c'est ainsi qu'une ombre sautillante le suivait en permanence, cachée derrière les murets, les robiniers, se fondant dans la verte chevelure des saules).
Comment faisait-il? Nul ne connaissait les coins poissonneux ni ne lisait le courant comme lui. Personne pour pêcher les bordures de rochers, pour lancer de façon aussi élégante, pour récupérer puis relancer dans le même mouvement, en artiste consommé. C'était un sepctacle à la fois très beau et qui donnait l'impression d'une présence, d'une adéquation presque vertigineuse. Disons le tout net: il y avait quelque chose de stupéfiant à le voir opérer, contredisant le caractère aléatoire de la pêche qui reflète les bonnes et les mauvaises fortunes de la vie. Car Joseph faisait mouche à chaque coup. Il y avait comme une sorte d'attirance magnétique au bout de ses doigts, une vraie sorcellerie! Même après avoir passé des après-midi entières à l’observer, à essayer de comprendre, je garde l’impression que son art ne découlait pas d’une maîtrise consciente ou consécutive à la découverte de quelque règle empirique, mais relevait du pur instinct. Non, il ne faisait pas partie de ces gens qui usent leurs forces en longues préparations et en savants calculs.
Dès avant l’aube, précédant le chant du coq, il s’échappait dans l’air nacré, pailleté d’or et de rosée, à peine vêtu, tout juste éveillé, couvert déjà par le regard scrutateur de quelque voisin matinal. Cette concupiscence, c’était le signe d’une journée qui s’annonçait laborieuse pour tous. D’abord, Joseph se mettait à bêcher pour arracher à la terre une poignée de lombrics qu’il enfermait dans de gros bocaux à confiture, sales et ébréchés (mais ce travail de prospection minière laissait forcément des traces: il y avait partout autour de la maison des trous dans lesquels nous trébuchions à tout instant). Ensuite, il disparaissait quelques instants dans la remise pour en retirer son attirail de pêche: la canne, les fils, l’épuisette aux mailles déchirées. En somnambule, il enfourchait sa bicyclette sur laquelle on le voyait se fondre, silhouette indécise, dans la demi-obscurité couverte de légers voiles ocre et bleu.
Qu’on ne s’y méprenne ! Invariablement, nous trouvions à notre lever, bien sagement alignées sur le zinc de l’évier, les victimes bleuies de ses meurtres et de ses rapines, yeux globuleux, plaies imprégnées de sang à vif. Ses prises, innombrables, étaient là, froides et leur présence imprimait quelque chose d’à la fois familier et trouble dans notre cuisine. C’était une nature morte d’une beauté étonnante, qui nous attirait en même temps qu’elle nous pétrifiait. Comme il se doit, on attendait que toute la famille se trouvât réunie pour vider le poisson, tâche dévolue à notre mère qui commençait par inciser à la base de la nageoire caudale ; s’étant essuyé le front du revers du coude, elle laissait ensuite courir la lame effilée jusqu’à hauteur des branchies avant d’introduire un doigt, puis deux, dans la fente ainsi pratiquée, sectionnant non sans délicatesse dans la cavité froide, extirpant un rein, un agglomérat spongieux, quelques semblants d’intestins roses ou blanchâtres.
Inutile d’ajouter que nous étions incontestablement fiers des terribles exploits de notre prestidigitateur – fiers de façon presque scandaleuse. Pour ma part, je ne demandais qu’à le suivre dans ses prouesses, mais malgré ses explications (que je livrerais volontiers dans l’espoir qu’elles puissent être utiles à quelqu’un), impossible de progresser. Or donc, Joseph avait établi à l'usage de ses proches une sorte programme d’apprentissage progressif qui retraçait quelques principes essentiels de la pêche en rivière. Il était impératif, selon ses vues, de commencer par le plus difficile, c’est-à-dire la truite elle-même, car qui maîtrise la truite sera capable de capturer par la suite n’importe quelle autre espèce de poisson. C'était vite dit. Dans les faits, je n'ai vu personne lui arriver à la cheville, malgré les heures passées à expliquer les nuances et les subtilités de la rivière.
À chaque saison, la table familiale regorgeait de fuseaux argentins remontés de ces lieux interlopes que sont les méandres et les tourbillons. On en troquait contre des légumes frais, on en offrait, on nourrissait les chats de leurs chairs pâles, au point que personne dans notre entourage ne savait plus à quelle sauce les apprêter. Mon frère n’assistait jamais lui-même à toutes ces transactions, commérages et échanges de recettes. Je crois que ça l’atterrait plutôt. Les salmonidés lui tombaient des mains, soit, il n’en tirait nul orgueil, mais nous nous demandions toujours par quel miracle notre petite rivière pouvait receler tant de ces corps élastiques, étincelants et disponibles – qui se nourrissaient de quoi ? Par la force des choses, j’ai donc dû me rabattre sur un art moins glissant, et le hasard voulut que ce fût celui de la capture des mots, pas si faciles non plus à lever sous les algues et les pierres au bout de la ligne plombée.
Bréviaire des eaux, extrait, in Verrières, n°6, juin 2001
09:20 Publié dans Bréviaire des eaux | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, pêche, truite, rivière
jeudi, 19 février 2009
Trouver la truite
J'ai toujours été un piètre pêcheur. Un jour, cependant, à rebours de tout bon sens, mon frère décida que je pouvais progresser. Il m'offrait de me prendre en main. Il m'avait fixé rendez-vous non loin de chez nous, au pied des ruines d'un moulin désaffecté qui menaçait à tout instant de s'effondrer. L'aube luttait avec le brouillard, qui s'étendait encore par bancs opalescents sur la campagne environnante. Je parvins près de ce bras de rivière où le courant ralentit, hésite, offrant une vue plongeante sur les algues qui tapissent le fond. Tout était à la fois léger et solide, grave et plaisant. Mon frère était déjà là, il m'attendait depuis un moment, sans impatience. Mon instruction devait se dérouler selon un cheminement simple pour lui, extrêmement subtil et incompréhensible pour moi. Selon lui, il s'agissait seulement de fonder la relation que nous entretenons spontanément avec notre environnement : le vent, la température de l’air et de l’eau, les odeurs qui flottent, s'entremêlent au vent, les variations et les jeux de la lumière, qui prend près de la surface d’un courant une calorie spéciale, insoupçonnée, toutes ces choses nous parlent un langage qui est celui de la vie même. Pour ce qui était des truites, il lui semblait tout d'abord primordial que je me débarrasse de quelques illusions, ce qui est plus difficile qu’on ne le croit. Les illusions ! Prenons par exemple celle, tenace, qui consiste à croire dur comme fer que le sapiens sapiens est l’animal le plus évolué de la planète, et donc le plus éclairé, adapté, persévérant, ingénieux, etc. À ce régime, vos chances de lever un jour au bout de la ligne transparente un salmonidé quelconque équivalent pour ainsi dire à zéro. Car la truite évolue dans ce qu'on peut considérer comme un miroir déformant, où notre reflet se consume à chaque seconde, se décomposant en mille petits éclats désordonnés. C'est un monde ultra-sensible, extra-lucide, hyper-pénétrant.
Il résulte de tout cela qu'il faut se faire une règle de se tenir à contre-jour, quoi qu’il advienne, et bouger le moins possible afin de ne pas éveiller les soupçons de la belle fugitive, car elle est comme nulle autre sensible au bruit, et d'ailleurs rien ne l’effraie tant qu'une ombre portée. D’une intelligence fine et délurée, elle aura tôt fait d’établir le rapport avec un de ces bipèdes voraces qui polluent son environnement et n’en ont qu’après sa chair fraîche. Disons, pour faire court, que pour les créatures qui vivent à la frontière qui sépare l'air et l'eau, c'est surtout la lumière qui donne sens à l'ondulation des algues, aux battements toujours particuliers du courant sur les berges, à la mobilité. C'est une grande pulsion qui emporte tout. Ici, le monde a sa richesse et son poids, et sa logique pourtant ressemble à une absence totale de logique. C'est le règne de la magie et de l'indéchiffrable. Mon frère n'était pas superstitieux, il ne croyait pas au surnaturel, ou plutôt il y faisait entrer tout le naturel dont il était capable, à chaque instant. Quand il trouvait une truite à trois ovaires, il ne s'en étonnait pas: une truite à deux ovaires est déjà, si l'on y songe, une énigme suffisante. Dans la vie, tout n'est-il pas question de dosage, discrétion, modestie?
Bon, voilà, si vous avez tout compris, il ne vous reste plus qu'à appâter... Après avoir entre-aperçu un bref reflet argenté qui se confond avec un reflet du soleil, vous venez donc de lancer, et la mouche flotte à quatre mètres de la berge, s'éloignant lentement au gré du courant. Parvenu à ce point, efforcez-vous de retenir votre souffle, même si un léger voile devait obscurcir votre vision. En dépit de la crampe qui s’empare de votre poignet, surtout, ne bougez plus! Cela vaut mieux que de l’effrayer. Armez-vous de patience, et plein de dévotion pour l‘objet de vos attentes, tel un mystique dans l’expectative de la révélation, laissez-vous aller à rêver, efforcez-vous de voir au-delà des apparences. Imaginez-la, essayez de vous projeter dans le vide des apparences... De toute façon, peut-être que vous la regardez déjà depuis un certain temps sans avoir réalisé que c’était elle qui vous chatouillait dans sa princière nudité sous les dessous de nylon de la rivière. Car s’il y a loin de la truite à l’oeil (deux, trois mètres tout au plus), le chemin qui sépare votre rétine de la pensée se compte, lui, en années-lumière d’axones et de synapses, autant de relais qu‘il vous faudra franchir par la force de votre volonté. Par conséquent, ne désespérez pas si vous n’apercevez rien avant longtemps. C'est bien normal. Ça viendra. C’est déjà là.
Bréviaire de eaux, extrait, in Verrières, n°6, juin 2001
15:30 Publié dans Bréviaire des eaux | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, pêche, truite
mardi, 20 janvier 2009
Musée égyptien (Turin)
D’un commun accord, nous nous sommes arrêtés devant les sarcophages
Dont la pierre, dans cet extrême de voir,
Semblait supplier par-delà la béance du temps.
Et je t’ai accueillie dans mes bras comme on défait des bandelettes pour
Mettre à nu ce qui se confond maintenant avec la stridence de la ville.
Mouvement des lèvres – à peine une supplique.
Autour de nous, ce viol du présent (mais c’était la condition,
N’est-ce pas ?). Comme tu me serrais le poignet, farouchement,
Un insecte ailé est sorti (toutes antennes frémissantes, aussi égaré
Visiblement qu’un voyageur du temps à l’instant où
La disparition se précise) du coffre sculpté.
Une blatte, je crois – l’héritage des momies ?
Je retrouvai (d’instinct) le geste des yeux dans l’ordre imparfait du monde.
À la sortie, le rouge du ciel comme une joue souffletée nous
Accueillit, attestant que la rencontre avait bien eu lieu.
Extrait d'Éoliennes, Ed. L'Âge d'Homme, 2007
03:53 Publié dans Éoliennes, quelques courants d'air | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poésie, turin, poème, littérature
vendredi, 12 décembre 2008
Fraîchement sorti de presse...
 Fidèles et surtout très inconscients lecteurs du virtuel, vous avez - enfin! - la possibilité de lire sur papier certains blogèmes, réunis au fil de ces pages à de nombreux autres aphorismes poétiques taillés dans le même bois - celui dont on fait les chaises, les livres et surtout les allumettes... Si la poésie vit d'espace, l'hiver venu, cet espace vient à manquer. Alors, c'est l'occasion de mettre un peu d'ordre dans l'élémentaire de nos sensations, de se réfugier Dans la noix du monde. Peut-être s'agissait-il tout simplement d'allumer une mèche dans l'obscurité de nos centres, plongeant l'être dans des états qu'il avait oubliés et qui le renouvellent?
Fidèles et surtout très inconscients lecteurs du virtuel, vous avez - enfin! - la possibilité de lire sur papier certains blogèmes, réunis au fil de ces pages à de nombreux autres aphorismes poétiques taillés dans le même bois - celui dont on fait les chaises, les livres et surtout les allumettes... Si la poésie vit d'espace, l'hiver venu, cet espace vient à manquer. Alors, c'est l'occasion de mettre un peu d'ordre dans l'élémentaire de nos sensations, de se réfugier Dans la noix du monde. Peut-être s'agissait-il tout simplement d'allumer une mèche dans l'obscurité de nos centres, plongeant l'être dans des états qu'il avait oubliés et qui le renouvellent?
Un livre est avant tout un acte de vie, une lutte contre notre indigence profonde, mais c'est aussi une trace de ce que l'on fut, là-bas, loin du bavardage et de la confusion, à un moment donné, comme un morceau de nuit arraché à la nuit... Voilà, disons: une entrée possible dans le grand labyrinthe du monde qui m'est apparu sous la forme à la fois rapetissée et magnifiée de la noix. La poésie n'est rien d'autre que cela: un saut dans l'inconnu. Une noix ouverte sous nos doigts...
Ou encore: une façon de subir la misère sans se laisser écraser, comme une échappée hors de soi, un éveil à ce qui est issu du plus profond. Oui, il faut avoir le courage de tâtonner... Et au bout de ce tâtonnement, une transparence survient, qui indique que l'unité espérée a été frôlée une fraction de seconde, ou que du moins quelque chose a pu être apaisé.
Le texte est précédé d'un entretien avec Patrick Vallon sur le thème de la poésie aphoristique en tant que vecteur de connaissance.
Lien de vente directe sur le site des Éditions l'Âge d'Homme
18:26 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, livre, aphorismes, pensées