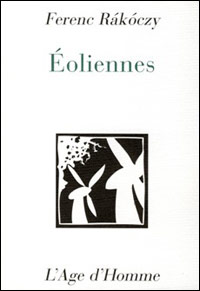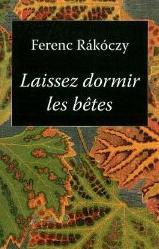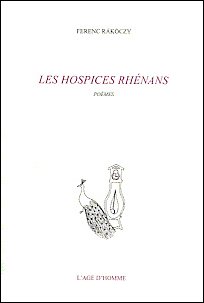samedi, 30 janvier 2010
Ce qui se trouve au fond du sac
Ecrivain tessinois de gauche, Plinio Martini (1923-1979) est de ceux qui, en publiant, ont tout engagé d'eux-mêmes : leur vie, leur enfance, leur vision du monde, et jusqu'à cette musique intime qu'on entend résonner comme une harpe éolienne au creux des vallons d'ombre de son pays. Il s'est ainsi créé une forme détournée de mystique qui transparaît tant dans dans ses romans que dans ses nouvelles, et les anime discrètement d'une vertu singulière, en quoi il dépasse la simple chronique sociale et politique - même si c'est une des lectures qu'on peut en faire. Quoi qu'il en soit, Le fond du sac (1970) apparaît comme le livre de la maturité et du souvenir, situé à l'opposé de toute littérature de confort, et à ce titre il se dessine comme un document sur le dénuement et la misère qui régnaient dans les vallées tessinoises encore jusqu'aux alentours de l'entre-deux guerres. A l'envers de toute idylle alpestre, il n'est guère de récit qui soit moins composé, écrit davantage d'inspiration.
Le fond du sac est avant tout la restitution fidèle d'un trajet de vie. Revenu au pays après un éloignement de dix-sept ans, Gori Valdi, le narrateur, se veut le témoin de la vérité, seule capable de le sauver de l'échec existentiel. Il va son chemin, se heurte, trébuche, s'obstine. Faisant son possible pour mieux comprendre ce qui lui est arrivé, il s'exprime dans un langage rude et dénué d'artifices : répétitions voulues, tournures populaires chargées de mots dialectaux, maladresses de la parole, hésitante et partagée. La bouche obéit mal lorsque le cœur murmure. Le personnage central s'adresse à un proche jamais nommé, un tu qui met le lecteur de plain-pied avec la réalité des faits, leurs causes et leurs répercussions. C'est donc avec violence qu'on est immergé dans le petit village de Cavergno, aux confins du val Maggia, où l'auteur et le narrateur ont tous deux grandi. A cette époque, le Tessin sommeillait depuis quelques siècles dans une pauvreté silencieuse. Pays de pierres, de solitude, de précipices, une peur sans nom et sans fin habite le cœur de ses enfants. On sent, douloureuse, immédiate, la présence de la misère, cette misère qui écrase irrémédiablement toute destinée sous le poids des maladies, de la famine, des sordides accidents de montagne. Toute activité, toute fièvre n'est bonne qu'à ça : survivre. On comprend que l'émigration se dessine alors comme une échappatoire, un mince espoir de salut.
Le pauvre Gori est englué sans merci dans ce mauvais sort ; après tout, son grand-père Venanzio n'avait-il pas déjà fait son balluchon à quatorze ans pour aborder sur les rivages d'une Corse tout sauf douce, où il exerça le métier de maçon ? Dans ce contexte, même s'il est amoureux de la charmante Madeleine, l'Amérique représente, peut-être, une petite lueur d'espoir. Plinio Martini a construit son récit autour de ce noeud gordien: la tension qu'il peut y avoir entre la nécessité de partir et la naissance du sentiment amoureux. Par un de ces paradoxes à la fois cruels et chers à l'auteur, la tentative de Gori pour échapper au désespoir par l'exil sera à l'origine de la disparition de Madeleine, la fiancée, l'unique amour, l'étoile suspendue à son ciel de chevrier. C'est par orgueil qu'il a voulu s'expatrier en Californie avec son frère Antonio, quitter la communauté, sortir du rang. Il pensait seul en payer le prix. Il lui faut Madeleine pour vivre, mais Madeleine sera bientôt, comme le reste, anéantie. En toute bonne logique, pourrait-on dire, c'est sa loyauté, son statut d'orpheline et son inscription dans une nouvelle filiation (elle contracte la pneumonie en rendant visite à sa future belle-mère) qui seront cause de sa mort. Ainsi fatalité intérieure et extérieure se conjuguent pour mieux briser les êtres au plus intime de leur ressort. Nul salut, nul apaisement. Pourquoi en va-t-il ainsi ? C'est la question que le narrateur se pose tout au long du récit. Le visage humain peut disparaître, tomber en poudre. Même les liens de l'affection semblent incapables de le protéger de son malheur, lorsqu'ils ne précipitent pas sa perte. Il y a là une manifestation d'un drame plus ample, pour ainsi dire cosmique, par lequel Madeleine devient victime expiatoire et signe de l'impuissance de la tribu face à une nature sauvage qui redemande périodiquement des innocents à dévorer.
Il n'est pas facile de résumer en quelques lignes les vibrations qui traversent ce roman. Presque tous les héros qu'on rencontre dans Le Fond du sac restent prisonniers du temps qui passe, ou du temps passé. De là vient une part de leur grandeur, mais pas la seule. A l'instar de Don Giuseppe, prédicateur d'une religion suffocante, dont le plus grand souci est de sauver les âmes qui lui ont été confiées (s'il ne se donne entier, il ne donne rien), Gori trouve sa rédemption dans le feu de la parole, cette flamme qui, soudain, éclaire tout, comme une lampe de ses rayons horizontaux. A la tradition et à l'ordre de l'Eglise, il oppose la parole de celui qui, littéralement, languit après les siens, que la pauvreté et une morale rigide éloignent autant que l'exil. Au cœur de l'attention que nous portons aux êtres se tient l'absence. Et c'est en prenant la mesure de cette absence que le narrateur parvient, par la conscience de l'inanité de toute chose, à réconcilier le dire et l'être, l'universel et le singulier, et à ainsi faire entrer le grand monde dans le petit monde de son canton, avec ses expériences, ses tribulations, la fascination que nécessairement il exerce. Ce qu'il cherchait était là, tout près, à portée de main.
L'Amérique de Gori, où il s'est enrichi pourtant, n'a pas rempli ses promesses. Il n'en revient pas les mains vides, mais ce qu'il a involontairement perdu, le coeur, un certain sentiment lié à sa jeunesse, son innocence, tout cela ne se retrouvera plus. Sans l'amour, il n'y a plus qu'amertume au fond du sac qui se noue sur les illusions d'une vie ouverte au bonheur, à la joie simple de fonder un foyer, de perpétuer la lignée ancestrale. Comment accepter de cheminer sans espoir, coupable et condamné ? L'impossible est consubstantiel au réel. C'est toute la thématique du devenir adulte, du deuil de l'enfance et de la douleur que cela comporte. Restent la lutte et cette étonnante lucidité qui vient de l'auteur, sans doute, tout en relevant profondément du personnage : une forme de sollicitude dans l'affliction, une voix qui reste et s'imprime, unique, dans la mémoire des hommes.
Le fond du sac, Plinio Martini, traduit par Jeanine Gehring, Poche suisse 69, éditions L'Âge d'Homme, Lausanne, 1990.
Article remis à jour en janvier 2010
18:50 Publié dans Plinio Martini | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature