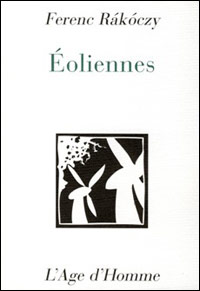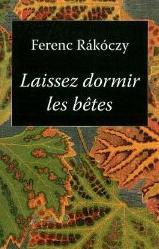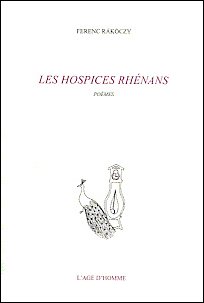samedi, 02 mars 2013
L’enfance, l’exil et le labyrinthe. Une lecture de la trilogie d'Agota Kristof

Le rire de l’identité
La trilogie des jumeaux fait partie sans doute de ces oeuvres qu’on peut qualifier de nocturnes, à telle enseigne qu’elles finissent par présenter de bizarres propriétés sous la lumière vive du jour : celle notamment de nous hanter longtemps après leur rencontre, celle surtout de heurter intensément notre sens moral et, au-delà de ça, dans son fondement même, notre vision du réel. Le programme est donné dès le premier chapitre du Grand Cahier, avec ce terrible rire de la Grand-mère, une aïeule monstrueuse qui se tape sur les cuisses pour mieux se moquer de sa fille dans le besoin, alors que celle-ci vient pour lui abandonner ses enfants. Et ses non moins terribles petits-fils ne sont pas en reste: nul respect vis-à-vis le l’aïeule, nulle crainte devant la figure toute-puissante sous la garde de qui l’on est voué à tomber et à qui on peut sans crainte tirer la langue, puisque de toute façon l'amour n'est pas, ne sera jamais ce qui les fait se rejoindre.
D’entrée de jeu, les liens du sang sont aussi malmenés que le sera par la suite la part d’humanité de tous ceux qui seront appelés à paraître – comparaître serait plus juste – sur la scène de cet insolite théâtre d’ombres. Le monde d’Agota Kristof est en vérité un monde bien étrange. Monde de l’enfance, où l’enfant n’existe qu’écrasé, broyé, en butte à l’ignominie sans appel de forces qui ne réussissent, au bout du compte, qu’à rendre sa survie plus ardue ; monde de la guerre, du totalitarisme, monde carcéral, ou même du soin, il s’agira de toute façon d’un monde dominé par la prédation, l’instinct, la résurgence de comportements schizophréniques, antisociaux et primitifs. Il n’y pas de faute, il n’y a que la peur, banale, mais active, d’être dévoilé, la peur, plus pernicieuse encore, d’être dépouillé de son identité.
On ne peut comprendre Kristof sans tenir compte de ce grand écart culturel et linguistique qui sous-tend toute son écriture, et qu’explique peut-être l’importance métaphorique de la frontière, cette séparation qui exténue notre humanité. Migrante, elle a fait de ses personnages, presque sans exception, des migrants qui, lorsqu’ils ne se transportent pas dans l’espace, campent sur les lisières de leurs exils intérieurs. Perpétuels rescapés des ravages de la politique et de l'Histoire, ils sont aussi à l’aise dans la solidarité que dans une sauvagerie sans mesure – on pourrait dire qu’ils réinventent pour leur propre compte la fameuse phrase de Joë Bousquet : « Qu’on me retire la vie, et j’en invente une autre. » Et, de fait, on peut considérer que les romans d’Agota Kristof, avec la tension interne qui les habite, nous mènent aux limites du surréel (ou encore du conte dont ils exploitent d’ailleurs certains ressorts).
Un bout de Hongrie mi-fictive mi-réelle
Même si l’auteur a pris soin de gommer toute référence explicite, on peut retrouver dans ses récits des habitudes et des coutumes hongroises, mais surtout cette terrible atmosphère de suspicion et de délation propre à la vie des pays du bloc de l’est avant la chute du mur. Fuir le totalitarisme en tant qu’aberration du réel semble devenu l’enjeu majeur de l'existence de tous les protagonistes. Qu’on soit faible, débile ou estropié n’y change rien : il faut fuir. Quand il n’y pas d’autre possibilité que de rester, de s’assujettir au système, on se mue en spécialiste de la subsistance, cette subsistance qui fait de chacun un animal réduit à la simple expression de son animale perspicacité. Car la révolte, en tant que telle, n’amène qu’à un écrasement de l’individu, et il vaut bien mieux s’arranger avec ce qui peut être arrangé. Mais la séparation demeure. Déterminée par les aléas de la guerre, de la folie ou des drames familiaux, par la nécessité de l’individuation ou encore les murs de l’institution étatique, elle est toujours absolue et irréversible ; elle suggère l’entropie d’un univers abandonné par Dieu et voué à la perspective d’une fin prochaine, et pourtant....
Et pourtant on y séjourne, comme dans les ruines d’une bataille à tous les coups perdue d’avance. L’incomplétude sera le sort commun de tous les personnages de la trilogie, où l’on ne compte d’ailleurs pas les infirmes. L’enfant étant par nature celui qui est le plus inachevé dans la société, il n’y a qu’à deux que la survie paraît envisageable d’une quelconque manière. À cet égard, le jumeau est à la fois celui qui pousse le plus loin ce principe et celui qui avance le plus incurablement troué : il a besoin de l’autre pour se compléter, pour limiter l’hémorragie. Être à deux, c’est se savoir à la fois différent et identique, c’est rechercher sans cesse une apparence d’unité dans le « nous » d’un refus, dans une attitude oppositionnelle à l’univers extérieur. Mais cette conduite également a ses limitations : elle rend impossible une véritable construction de soi, elle instille en définitive la méfiance dans les fondements du lien.
Plus que cela même, la gémellité coupe le sujet en deux parts hétérogènes, l’empêchant de réunir les fragments épars de son moi, le maintenant dans une tendance involutive et régressive qui est l’état d’ambivalence de l’univers mythique. Et cette dissociation finit par le détruire. Pour maintenir un semblant d’unité, il est contraint à fourbir des armes aussi subtiles que dangereuses, à savoir l’ironie, la ruse, les mortifications (d’une cruauté digne de l’ordre religieux le plus intransigeant), les humiliations du jeu, l’abus du faible.... Comme chez le cinéaste hongrois Béla Tarr, la propagation du mal, ici, atteint son paroxysme, s’étendant de proche en proche, jusqu’à gripper le cosmos, dans une perspective d’infiltration totalisante et pour ainsi dire ontologique.
Le minimalisme du style narratif, qui marque le vocabulaire aussi bien que la syntaxe de la trilogie, ajoute à cette contamination. Par l’abolition de la distance discursive, l’écriture scelle en quelque sorte le destin des personnages. Dans le Grand Cahier, roman à la fois fragmentaire et total, volontairement dépouillé et direct, elle semble motivée par l’âge des jumeaux et leur zèle de diaristes en herbe. Ce n’est pas seulement que le détachement émotionnel ordonne l’approche des lois naturelles. Cette sécheresse de la forme est à plusieurs reprises médiatisée, notamment dans un chapitre intitulé Nos Études, où l’on voit les jumeaux aux prises avec les choix esthétiques à effectuer pour leurs exercices d’écriture. Pour qu’un notation reçoive la mention « bien », ce qui lui confère du coup le mérite d’être recopiée dans le grand cahier, elle doit satisfaire « à une règle très simple : la composition doit être vraie. ». Il y donc une équivalence entre l’écriture et le monde (de même que l’état de jumeau parfaitement assumé peut exprimer l’unité d’un dualisme équilibré). Seulement c’est un monde où l’on tombe en permanence, et sans jamais pouvoir compenser sa chute.
Est-il possible de se sauver en écrivant ?
Pas étonnant que tant de personnages de la trilogie, en butte à leur malaise identitaire foncier, se mettent, à un moment donné, à tailler leur crayon, allant jusqu’à sacrifier ce qu’ils ont de plus cher. Ainsi en va-t-il de Victor qui, dans un premier temps, vend sa libraire afin de pouvoir se mettre à rédiger son livre, et finit par assassiner sa propre sœur, ne supportant pas son sacrifice pour l’œuvre en gestation. Écrire, c’est surtout se réécrire. Pour Claus-Lucas, la situation montrée dans le Troisième Mensonge est quasiment la même que celle décrite dans le Grand Cahier, mais vectoriellement inversée. À l’instar des états totalitaires et de ses suppôts qui falsifient l’histoire à mesure, le personnage central plonge dans son passé pour expliquer comment il s’est formé, mais cette démarche, absolument insuffisante pour se décoder, mais n’aboutit au bout du compte qu’à un délire sur les origines, voire même à un délire d’auto-engendrement, une explosion d’interprétations qui se chevauchent et s’excluent les unes les autres. Le paradoxe et la réussite de ce dernier livre tient précisément à cet aspect labyrinthique qui mure C(K)laus-Lucas dans sa solitude, sa souffrance, la répétition de ses rêves et de ses hantises.
En tant qu’accès illimité à l’imaginaire, la tenue d’un cahier d’écriture protège comme protègerait un fétiche, cet objet de transfert magique, d’unification du primitif. Salvifique, la réécriture du quotidien permet un certain détachement face à une séparation qui ne peut qu’avoir été vécue dans l’effroi. Les explications ne comptent pas dans ce monde où nous nous trouvons englués, de sorte que tout se vaut à la fin. Il résulte de tout ceci que le narrateur n’existe qu’à travers les méandres de son récit : il n’éprouve nul besoin d’éplucher, peler ou décortiquer les événements ; il lui suffit de tout transformer, de réinventer d’autres voies et détours, de se vouloir le catalyseur d’un bouillonnement – de ce grand bouillonnement qui fait le vivant. Le style, qui se manifeste par l’accumulation d’actions et surtout de dialogues, et qui pourrait faute d’un examen superficiel être qualifiée de « behavioriste », apparaît alors comme une mise en scène aux frontières du fantastique et du récit cyclique.
Du roman familial à la fable politique
En effet, plus on avance dans la trilogie, moins on est capable d’ordonner les différents niveaux qui se tissent ainsi qu’un palimpseste les uns aux autres. En même temps, on retrouve quelque chose de l’ordre du roman familial freudien, où l’enfant se réinvente des ascendants autres que les siens, ou encore réinterprète la scène originaire à sa façon. Chez Agota Kristof, cette scène primitive apparaît toujours désordonnée et violente : les parents meurent sous les yeux de leur progéniture, la mère allant même dans le cas extrême jusqu’à tuer son époux ; et c’est toujours ce traumatisme initial qui entraîne l’abandon et le fait d’être recueilli par un tiers le malveillant, qui humilie sur le plan physique et spirituel.
Si le roman familial devrait normalement permettre à l’enfant d’échapper à la conflictualité interne de l’Œdipe, rien de tel ici. Une fois de plus dissocié (déconnecté), le fait de « se raconter des histoires » ne prend toute sa valeur que par rapport à l’imagination elle-même, car c’est à travers celle-ci que s’accomplit dans toute sa plénitude le réel qui n’est pas seulement reconnu, mais accueilli dans toute l’obscurité de ses pores. En quoi le « je » des deux derniers tomes, à force de factualité, apparaît largement anonyme, et donc revêtu d’un important caractère universel (ce qu’il traverse est à la fois si proche et si décalé que chacun peut tour à tour s’identifier à lui). Et cependant, impossible de déceler une quelconque assise au « moi » du narrateur. Si la trilogie des jumeaux témoigne d’un profond malaise, peut-être est-ce parce que les rapports humains demeurent jusqu’à la fin dans la confusion d’un microcosme complètement altéré.
On peut malaisément commenter une telle opération et encore plus malaisément encore la livrer aux approximations de l’exégèse. Disons simplement que dans la trilogie l’imaginaire et le réel se confondent au point que même les actes transgressifs se présentent comme des manifestations ordinaires de l’être humain, juxtaposées à d’autres manifestations non-transgressives, sans nulle hiérarchisation morale, sans aucune signalisation, dans l’éclair rigoureux de leur surgissement. Oui, l’écriture simplifiée à l’extrême d’Agota Kristof est tout à la fois forme et contenu ; elle ne contient que sa forme même, un vide, et non une réalisation de soi.
Il y a tant de versions, tant de pistes décapitées, de retournements, que surnage à la fin l’interprétation à laquelle on s’était le plus attaché. Peut-être est-ce l’une ou l’autre page du Grand Cahier, avec sa succession de leçons magistrales sur l’enfance ? Peut-être pas. Car on ne se perd pas seulement dans ces grands labyrinthes de papier pour mieux se retrouver, mais pour jouer. Survivre, jouer, se recréer – peut-être nous faudra-t-il apprendre que dans certains cas cette acrobatie n’est guère autre chose qu’une des nombreuses figures de la littérature, de son génie germinal ? Allégorie politique et sociale du communisme en tant que système, elle décrit ici la dégradation des êtres et des sentiments face à l’absence de repères justes et stables, et l’absurdité d’un système qui, s’il fonctionne à vide, n’en apparaît pas moins intégré au quotidien et unanimement accepté. Il demeure ce manuscrit, ce grand cahier, exemplaire et mensonger, toujours à réinterpréter, toujours inachevé, à se donner à soi-même, synonyme de force et d’intimité, comme un embryon, s’éboulant de ligne en ligne, de vie en vie.
18:41 Publié dans La trilogie d'Agota Kristof | Lien permanent | Commentaires (3)