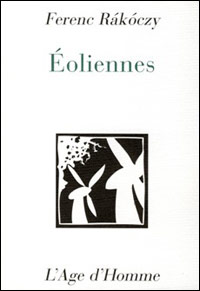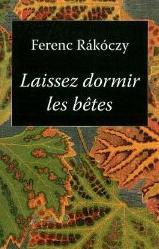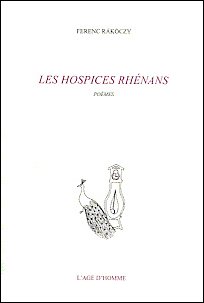vendredi, 13 avril 2012
Les Jeudis de l’Avenue du Théâtre (Lausanne)
Un archipel de poésie romande
Lecture-présentation le jeudi 10 mai 2012 à Lausanne
Mousse Boulanger ○ Maurice Chappaz Pierre Chappuis ○ Edmond-Henri Crisinel Jean Cuttat ○ Vahé Godel ○ Georges Haldas Philippe Jaccottet ○ Monique Laederach ○ Jean-Georges Lossier ○ Pierrette Micheloud Anne Perrier ○ Ferenc Rákóczy ○ Werner Renfer ○ Gustave Roud ○ Pierre-Alain Tâche ○ Jean-Pierre Vallotton ○ Alexandre Voisard ○ Pierre Voélin ○ Frédéric Wandelère ○ Luc Wenger ○ et quelques autres sans doute au gré du joli vent de mai
Pour honorer le Printemps des poètes, Ferenc Rákóczy a le grand plaisir de vous convier à une soirée dédiée le 10 mai à19h à quelques poètes romands édités par l’Age d’Homme, poètes qu’il présentera et lira avec Nancy Chevrolet.
À cette occasion, le peintre Nicolas Bertholet donnera, sur toiles grands formats, une libre interprétation des lectures choisies.
La soirée aura lieu dans les locaux des éditions de l’Age d’Homme, à l’avenue du Théâtre 2-4, 1002 Lausanne (accéder par l’escalier qui descend à droite – donc côté ouest – du bâtiment de Coop-City St-François).
Entrée libre
21:18 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (3)
mercredi, 29 février 2012
Blogème XCV
L’erreur est la meilleure des pédagogies, parce qu’elle nous enseigne l’ordre nonchalant des choses, et que la marche du monde sera toujours incertaine, cahotante, marquée par mille et un détours ou accidents.
08:52 Publié dans Blogèmes | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 07 février 2012
Mathias Clivaz aux Jeudis de l'Avenue du Théâtre (Lausanne)

Pour inaugurer les Jeudis de l'Avenue du Théâtre, Ferenc Rákóczy a le grand plaisir de vous présenter Ny aina de Mathias Clivaz, qui lira avec Sébastien Duperret son texte le 23 février à 19h.
Ny aina est le récit d’un voyage à Madagascar où l’auteur a été professeur de français et de philosophie entre 2008 et 2009.
La soirée aura lieu dans les locaux des éditions de l'Age d'Homme, à l'avenue du Théâtre 2-4, 1002 Lausanne.
Entrée libre.
Cliquez ici pour trouver le livre sur le site des éditions de l'Age d'Homme
20:30 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (3)
vendredi, 06 janvier 2012
Blogème XCIV
Ce n'est pas ce que tu penses qui importe mais ce que tu penses pouvoir changer.
12:00 Publié dans Blogèmes | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 02 janvier 2012
Blogème XCIII
Vérité, affaire de police et de magistrats; quant au reste, tiens-t'en plus modestement à la confidence des anges.
19:05 Publié dans Blogèmes | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 18 octobre 2011
La rentrée, vive la rentrée littéraire!
«Les régimes totalitaires brûlent les livres, la démocratie les noie.»
Jean Zéboulon, Pensées pour moi-même et pour quelques autres
23:09 Publié dans Perles noires (citations II) | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 19 septembre 2011
Blogème XCII
État d'exception: respire le présent par tous les pores.
13:06 Publié dans Blogèmes | Lien permanent | Commentaires (2)
samedi, 13 août 2011
Elias Canetti (1905-1994)
« L'ordre est plus ancien que le langage, sinon les chiens ne pourraient pas le comprendre. »
In Masse et Puissance (1977)
23:37 Publié dans Perles noires (citations II) | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 07 août 2011
Les jeudis du Grand-St-Jean (Lausanne)
Vous êtes tous cordialement invités
le jeudi 25 août 2011, à 20h
à la place Grand-St-Jean 1, 1er étage.
Anne Corthay, comédienne, et Ferenc Rákóczy y liront
pour leur plaisir et le vôtre,
Le Bord des Limbes,
pièce en un acte pour deux personnages -
sur le thème du déni de grossesse
PS: prière de s'inscrire sur le blog
00:30 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (3)
samedi, 25 juin 2011
Blogème XCI
Prends soin de laisser des cadres vides dans ta vie.
14:34 Publié dans Blogèmes | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 21 juin 2011
Blogème XC
Ne t'arrête pas une fois que tu as ouvert la porte, ô serrurier du réel. Mets de côté tes crochets et tes clefs, fais le premier pas les yeux fermés.
04:17 Publié dans Blogèmes | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 19 juin 2011
Proverbe alsacien
« Seuls les poissons morts nagent avec le courant. »
22:43 Publié dans Proverbes et sornettes | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 14 juin 2011
Blogème LXXXIX
Pour durer, maintiens en réserve quelque chose qui ne soit pas toi.
19:19 Publié dans Blogèmes | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 18 avril 2011
Éoliennes, une lecture poétique
Ferenc Rákóczy a voulu donner ici une sorte de bande-annonce d'Éoliennes, son livre poétique le plus important. On peut donc le voir et l'entendre lire des poèmes et des poèmes en prose qui parlent du vent qui souffle sur l'enfance, du processus de la création artistique, de l'expérience d'aller chez le coiffeur, ou encore de la mort de sa grand-mère. Comme il le signale lui-même à la fin du livre dans une note qui énonce une sorte d'art poétique poussé par la nécessité, le poète serait « le rescapé d'une époque d'anti-lyrisme, de minimalisme et de non-réciprocité qui [l]étonne chaque fois qu'[il] se heurte à elle ».
"L'art et le reste", "Rendez-vous du vent", "Salon de coiffure", "La confrérie du cerf-volant", "Prière pour la nouvelle année", "Dimanche" et "Mémorial", sont tous tirés d'Éoliennes, éditions L'Age d'Homme, Lausanne, 2007.
21:53 Publié dans Ferenc Rákóczy lit pour votre seul plaisir | Lien permanent | Commentaires (3)
lundi, 04 avril 2011
Tchernobyl, vingt ans plus tard
Trois poèmes qui racontent le voyage de Ferenc Rákóczy sur les lieux de l'accident nucléaire de Tchernobyl. L'auteur, qui lit lui-même ses poèmes, a voulu ici essayer de donner sens à ce qui, de toute façon, échappe à tout sens.
"Vingt ans plus tard", L'arbre de connaissance" et "La chute", tirés de: Éoliennes, éditions L'Age d'Homme, Lausanne, 2007.
18:05 Publié dans Ferenc Rákóczy lit pour votre seul plaisir | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : tchernobyl, lecture, vidéo
lundi, 14 mars 2011
Devant Tchernobyl
Ballet aérien
Nous étions paralysés devant le téléviseur, jour et nuit, depuis une semaine.
Les caméras du monde entier regardaient avec effroi
Par-dessus l’épaule des premiers sauveteurs – militaires pour la plupart.
Sous les casques, visages poupins des pilotes d’hélicoptères.
Tournant dans le ciel aimanté de suie fondante, ils effectuaient
Vol sur vol , en virtuoses,
Sans jamais se retourner – vrille vers un Moloch de non-être –
Ni sur eux, ni sur leur famille, ni sur ce monde vulnérable
Dont la forme s’estompait comme lors d’une opération du cerveau.
Anges d’une espèce sans calcul, survivant là où même les microbes ne peuvent survivre, anges au corps lourd, bien plus lourd qu’avant (mais de gaze froide), matérialisés là-haut telle une masse de cellules cancéreuses pour se calciner sur les bords de l’univers, parmi les dynasties déchues, admis aux dessins éternels de la terre, à telle enseigne qu'on dirait la base d'un nouvel espace vectoriel.
Des années plus tard, je rêve encore
De ces grands insectes aux ailes galvanisées.
Course au-delà de la mort. Boucle de temps qui se condense, se distend.
Est-il permis, dans de telles conditions, de parler de courage ?
D’un nécessaire devoir ? De peser l’abnégation ?
Sacrifice incroyable, son éternité n’a pas de fin.
La chose est à la fois absente et colossale:
Il n'en reste qu’un trou dans la poussière de la mémoire.
Et peut-être la lévitation d’un cœur en métal (parfaitement rembobiné).
Ce qu’il faudrait de présomption pour comprendre (comprendre quoi ?).
Ce qui dure et se répète à force d’être intolérable et surexact.
S'infecte de ses preuves.
Là où il n’y a plus de possible, plus de bifurcation – un centre vide.
Seulement un pur espace de logique et de faits.
La terre criblée de ce qu'on ne peut pas dire, de ce qui n'en finit pas.
Ainsi nous fut donnée une nouvelle image de nous-mêmes.
Ainsi cheminerons-nous à jamais exposés à l’inconnaissable.
Éoliennes, L'Age d'Homme, 2006
23:10 Publié dans Éoliennes, quelques courants d'air | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 02 février 2011
Les jeudis de la Louve (Lausanne)
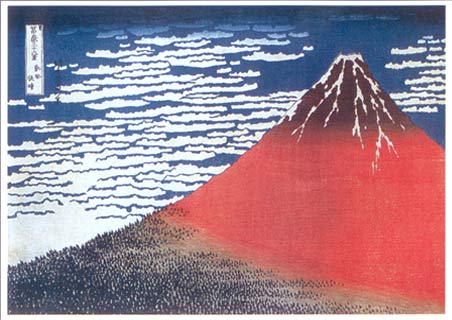 Guy Raffalli, flûte
Guy Raffalli, flûte
Dans la Musique du Monde
(Visions pour flûte expérimentale, néo-classique et subversive)
Jeudi 24 février à 20h
Place Grand-St-Jean 1
Mei (1962), de Kazuo Fukushima
Sequenza I pour flûte (1958), de Luciano Berio
Requiem (1956), de Kazuo Fukushima
Cinq Incantations pour flûte (1936), d’André Jolivet
Shun-san (1969), de Kazuo Fukushima
Le programme sera précédé d’une soupe hivernale et soutenu par la lecture de textes de Ferenc Rákóczy (Éoliennes)
Entrée libre, prière de s'annoncer, les places étant limitées!!!
09:27 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 26 janvier 2011
"Bleu Magritte" ou les amours de Louise Anne Bouchard
Née à Montréal mais installée en Suisse depuis près de vingt ans, Louise Anne Bouchard a publié huit romans et un recueil de nouvelles. Cet auteur, qui prétend écrire sous le signe d'une transe totalement assumée (ce qui en fait une lointaine disciple d'André Breton), s’est vue adjuger en 1994 le Prix Contrepoint de la Littérature pour La Fureur, un roman déconcertant et hypnotique qui raconte l’histoire d’un amour incestueux entre une jeune fille de 17 ans et son père. Nous avions déjà été touchés par ce livre d’une force poignante et d’une très grande densité, qui donne à voir – de l’intérieur – la transgression des normes, face à une réalité perçue en sa monstruosité sociale, inacceptable et pourtant vécue dans l’abandon et la passion partagée. Car ici la fiction ne dérange jamais ce qui, dans sa présence au monde, est son poids de passé, ce silence que rien ne peut troubler, sinon le pépiement d’un oiseau sur le bord de la fenêtre.
On peut dire que, de façon générale, le couple et les différents costumes qu’il est amené à prendre au cours des âges de la vie, apparaît comme le principal matériau de la recherche romanesque de Louise Anne Bouchard. À travers ces destins qui se croisent dans la souffrance et la révolte, ses récits déroulent, en profondeur, le thème éternel de l’être humain dont la soif d’absolu se heurte aux multiples obstacles que constituent les habitudes, les pouvoirs établis et les faiblesses même de l’individu. Des anecdotes croustillantes, de l’exagération, de la méchanceté, de la poésie, une certaine crudité parfois, de la description méthodique, bref, de beaux miroirs même s’ils sont parfois déformés. Car tout est toujours polarisé dans l'univers de Louise Anne Bouchard, et nul jamais n'échappe à son destin.
Bleu Magritte, son dernier ouvrage, raconte avant tout les amours enfantines de Douce, une petite Montréalaise, fille d’un criminologue, égarée dans l’Uccle, quartier chic à la lisière de Bruxelles, et qui pourrait bien être comme une sorte d’alter ego fictionnel de l’auteur. Au hasard d'une rencontre devant une vitrine, elle tombera amoureuse d'un garçon de son âge, qu'elle fréquentera neuf mois, le temps d'une gestation. Tout est toujours quête dans le regard de ces personnages pas si naïfs que cela au demeurant : quête de tendresse, de reconnaissance, d’un nouveau langage secret – celui des amoureux, qui échappe à tout dictionnaire. Comment ne pas se sentir proche de ces pages sur l'enfance, quand tout sonne si juste, si proche de l'émotion véritable?
En parallèle, on y propose une réflexion très pertinente sur le passage du temps, qui tamise les expériences et leur redonne une fraîcheur, une labilité, une transparence nouvelle dans la lumière du regard qui a su prendre le risque d’aimer. Il est un point nodal d’amour où présent et passé se confondent dans la conscience émerveillée. La trame romanesque de ce beau livre est excessivement prenante, et les figures centrales sont fulgurantes, inoubliables. Tout semble sourdre du dedans. Une écriture d’un classicisme exquis, un émerveillement des mots, une langue précieusement juste. Le discours amoureux y prend l’ampleur d’une métaphore de la force germinatrice, toujours en mouvement, comme un morceau de jazz très enlevé, comme les phénomènes de transe à travers lesquels l’écrivain prétend lire le monde, à la merci des évènements, et cependant toujours fidèle à elle-même et aux impératifs de son art.
Bleu Magritte, Éditions de l'Aire, Vevey, 2010
21:02 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (3)
mercredi, 28 avril 2010
Laissez dormir les bêtes
 Chers amis des animaux et des lettres, une fois n'est pas coutume, voici l'annonce de publication pour mon dernier livre, au dos duquel on peut plus ou moins lire après avoir chaussé les lunettes d'usage:
Chers amis des animaux et des lettres, une fois n'est pas coutume, voici l'annonce de publication pour mon dernier livre, au dos duquel on peut plus ou moins lire après avoir chaussé les lunettes d'usage:
« Un homme attaché qui hallucine sur son lit, une cuisinière pleine de sollicitude pour les escargots, un orphelin métamorphosé en carpe, des gens du voyage parqués sur une décharge chimique, une jeune femme volontaire et sensuelle, mais qui ne s’accepte pas, un groupe d’artistes peintres dévoyés par leurs folles ambitions, qu’est-ce qui peut bien rassembler des destins à première vue si épars ? Peut-être le besoin de retrouver, en dépit du caractère fragmentaire de toute existence, un peu de fraternité, un idéal qui permette de se soutenir, mais aussi et surtout les voies de la vie secrète – rêves, fantasmes ou obsessions. Comment se reconstruire à partir de l’irréparable cassure ? Comment dormir quand on est condamné à perdre sans cesse ce qui nous importe le plus ?
C’est ces dilemmes que chacun des personnages qui hantent ces pages tente à sa façon de résoudre. Pour ces animaux ultrasophistiqués que nous sommes devenus, à des années-lumière les uns des autres, enfoncés dans la recherche d’une vérité inatteignable, quel espoir reste-t-il ? Loin de l’exhibitionnisme sordide, de l’impudeur ou de la dérision, ces six récits semblent avoir été conçus comme des romans miniatures et, à ce titre, ils expriment une certaine façon de se mouvoir au cœur du monde contemporain. Quoi qu’il en soit, les fictions flamboyantes de Ferenc Rákóczy, souvent drôles, toujours inspirées et aussi imprévisibles que l’être humain lui-même, nous infligent une profonde secousse morale tout en nous restituant notre part d’humanité. »
Laissez dormir les bêtes, récits, L'Age d'Homme, Lausanne, 2010
Lire un avis sur Critiques libres
Commander Laissez dormir les bêtes sur le site des éditions l'Age d'Homme
23:13 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
dimanche, 07 mars 2010
Simone Weil (1909-1943)
La pesanteur et la grâce
13:36 Publié dans Paroles ouvertes (citations I) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature