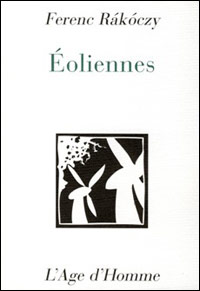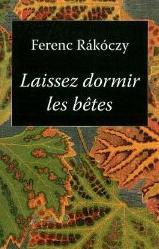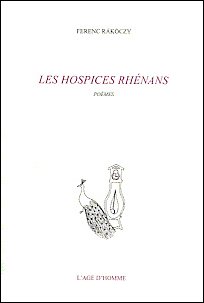mercredi, 20 novembre 2013
Le train dans la malle
Cet automne, comme je passais une semaine chez mes vieux parents, ma mère me fit remarquer qu’il y avait toujours cette malle au grenier, qui m’appartenait plus ou moins, et qu’elle me priait de débarrasser pendant les vacances. Depuis quelque temps, disait-elle, secondée par mon père qui résistait pourtant de toutes ses forces, elle avait commencé à mettre de l’ordre dans la maison.
Les journées qui suivirent, je tournai autour de la porte du grenier attenant à ma chambre d’enfant. C’était une porte en bois blanc qui obligeait à se courber profondément pour accéder à la soupente tellement elle était basse. Impossible de pousser ce loquet. Je trouvais toutes sortes de dérivatifs : le jardin, les amis qu’il fallait visiter de toute urgence, le défilé incessant des cousins qui ont tant compté dans ma jeunesse et que je revois toujours avec plaisir.
Je fuyais, mais ce que je fuyais, je ne le savais pas.
Ma mère revenait à la charge, c’en devenait inconvenant. N’en pouvant plus, je cédai.
Lorsque la porte s’ouvrit, il me fallut plusieurs minutes pour m’habituer à la pénombre du grenier qui me parut du coup beaucoup plus étroit que ce que j’avais gardé en mémoire. Je fis un pas, puis un autre, m’arrêtai à un endroit où le plancher craquait vraiment très sinistrement. Il me semblait baigner dans la chaude atmosphère d’une serre. Une chauve-souris me frôla de son aile vive ; comme j’aurais aimé lui ressembler, si légère, saisissant des oscillations invisibles, prévoyant les remous d’air à la façon d’un sismographe inconscient !
Le coffre était bien là où je l’avais imaginé, tout au fond, coincé sous les poutres qui descendaient jusqu’au sol.
Lorsque je soulevai le couvercle, je ne vis rien d’abord, tant la poussière volait autour de moi, s’élevant en tourbillons mordorés vers le puits de lumière formé par l’œil-de-bœuf.
Je plongeai mes mains au fond de l’espace noir, mais elles ne rencontraient que des cahiers moisis, des monceaux de papier poisseux qui s’effritaient quand j’essayais de les extraire de ce tas humide et légèrement dégoûtant. Je croyais aller à la rencontre de mes souvenirs, je ne trouvais que pourriture, décomposition.
Soudain, mes doigts butèrent sur quelque chose de dur. Non, je ne me trompais pas. Un angle, un arrondi, des crochets. C’était bien lui... Je le ramenai délicatement à moi, le soulevant par un bout, à la verticale. Il résistait, c’était comme s’il avait voulu rester là où je l’avais oublié pendant tant d’années.
Mon train. Mon bon vieux train.
Un de ces trains en bois, à la peinture si écaillée qu’elle commença à s’effriter lorsque je l’enserrai pour bien maintenir les wagons accrochés les uns aux autres.
Le train de mes rêves.
Aux alentours de mes cinq, six ans, je faisais un rêve récurrent et tenace qui me remplissait de terreur.
Voilà ce dont il s’agissait.
Je marche à travers une campagne désertique, au bout de laquelle, invariablement, se dresse un pont qui enjambe une vallée sombre. Ce pont, pourtant relativement modeste, comporte deux tabliers accolés: chacun d’eux est composé d’une épaisse dalle supportée par des poutres en acier liées entre elles par des entretoises perpendiculaires. Je le traverse sans me retourner, je chemine prudemment entre les treillis de protection qui bordent – des deux côtés – les voies électrifiées.
Je l’entends, il y a, quelque part, perdu dans un segment d’espace-temps indéfini, un train qui roule, qui roule, roule de plus en plus vite, s’approchant dans un fracas indescriptible. À mesure que j’avance, le danger prend forme et la peur me colle au ventre, éclate comme un abcès, déborde. Je supporte vaillamment cette sensation affreuse parce que je suis seul et que cela rend la chose moins pénible. La solitude a ses avantages, après tout…
Et soudain, le train est là.
Il me fonce dessus.
En toute logique, je m’anéantis – je m’anéantis et revis aussitôt.
Un blanc. Et je me réveille en sueur.
Je me lève, je descends à la cuisine, mange un morceau de pain. J’essaie de reprendre pied dans une nouvelle journée.
C’est ainsi que je vis jour après jour, revivant et m’anéantissant dans des cycles sans fin, comme si tout pouvait arriver, à n’importe quel moment.
Maintenant, ce sont bien entendu d’autres trains qui foncent sur les voies de ma vie (qui n’est jamais rectiligne comme dans le rêve!), et je n’y prends pas toujours garde. Maintenant, j’ai parsemé les gares de malles qui contiennent toutes sortes de jouets plus ou moins dangereux, plus ou moins inoffensifs et bienfaisants. Mais qu’importe!
Le soir même, j’ôtai la poussière incrustée dans le vieux bois et le nettoyai avec un chiffon humide. Je redressai encore une vis rouillée qui sortait du ventre de la locomotive. Mon père m’observait d’un air dubitatif – il se trouvait très loin déjà, embarqué dans des rêveries autrement plus mélancoliques. Je n’avais pas fini qu'il dormait dans son fauteuil.
Puis, j’empaquetai le tout, précieusement.
Notre humanité brille dans l’enfance qui seule la sauve des excédents de réalité qui nous blessent sans qu’il soit toujours possible pourtant d’échapper à ce laminoir.
Sur la banquette du compartiment qui me ramenait chez moi, je posai le sac qui contenait le vieux train. Sous le regard vaguement amusé de mes voisins, je le pris sur les genoux, comme on berce un enfant convalescent.
À mon retour, je l’offrirais à mes deux fillettes.
J’imaginais déjà leur joie, j’entendais les mille et une histoires qui sortiraient de leur imagination, s’enroulant comme des guirlandes colorées autour de ma nostalgie.
Par avance, je savourais cet instant.
12:09 Publié dans Bréviaire des eaux | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 13 octobre 2013
Le secret d'une vie
Le jour de la mort de mon oncle, on apposa des scellés sur sa porte. Je me souviens avoir tourné longuement autour des bandes jaunes, hésitant à les arracher. Ce n’est que cinq semaines plus tard que nous eûmes le droit d’entrer dans le petit appartement humide qui nous parut dans un état de décrépitude évoquant un monde en ruine. Il avait été médecin de famille pendant trente-cinq ans, et nul souci de retraite ne l’avait jamais effleuré. Son logis était pauvre et triste. Le cœur serré, je l’imaginai vivotant là-dedans, se confectionnant pour finir le dernier cocktail, celui qui nous emporte dans l’ivresse du renoncement. Il en parlait quelquefois comme de l’« ultime tremblement de terre, celui qui fait trembler même le plus fort d’entre nous ».
On fit l’inventaire de ses biens : un lit, une table, trois rechanges de linge, des vêtements ordinaires, un jeu de cannes à pêche, des ustensiles de ménage et surtout, des centaines de livres entreposés du sol au plafond sur plusieurs rangées.
On découvrit également, dans un carton qui gondolait en tous sens, des piles de feuilles couvertes de son écriture: son roman, composé dans le plus grand secret.
Pour ce que j’en compris, cette chronique touffue évoquait la vie d’un certain Thomas, alpiniste, campé comme d’une légende vivante que son auteur faisait se mouvoir dans un décor de carte postale. J’identifiai certains personnages (ils avaient beaucoup de traits communs avec mes proches), reconstituai certaines situations de sa propre biographie, pris du plaisir à suivre l’intrigue (convenablement embrouillée) et me perdis au milieu d’un passage évoquant des chutes de pierres au beau milieu d’une ascension particulièrement périlleuse.
Manifestement, il avait pris un plaisir énorme à coucher tout cela sur le papier, donnant vie à tous ces personnages comme s'il les avait assidûment fréquentés au quotidien. Chacun de nous est une foule. C’est ainsi qu’on abrite mille figures différentes, qui cohabitent en nous de façon harmonieuse ou chaotique et se révèlent en fonction des lieux, des moments et des personnes auprès desquelles on se trouve.
Toute la fin de son histoire se perdait en une digression interminable: sur l'amour, l'idéalisme, sur notre place dans le monde, sur l'action de l'homme dans ce monde. J'étais jeune, la culture me manquait pour saisir de manière exhaustive les idées maîtresses du texte.
J'imaginais mon oncle en train d’écrire à sa petite table après de dures journées, et cela me plongeait dans des abîmes de perplexité. Je réalisais que j'avais pour ainsi dire fréquenté un inconnu.
Mon oncle, pendant des années, dans son cabinet de campagne, s’était dévoué corps et âme (expression des plus appropriées au demeurant !) aux autres, subissant mille pressions pour renoncer aux dimensions de sa personnalité qui n’entraient pas en jeu dans sa vocation. Souvent, et avec humour, il avait évoqué son sentiment d'être « dévoré par son prochain comme une mie de pain ». À l’automne de sa vie, il s’était consacré à son jardin, faisant pousser des tomates, des haricots verts, des concombres qu’il distribuait dans le voisinage. Il avait creusé un étang, s’était mis à l’élevage des carpes, et quelquefois des chevreuils y venaient boire...
Je suppose donc qu’il devait écrire la nuit, dans ces moments interstitiels qui confèrent une capacité effective à mobiliser quelque chose de profond parce que la veille on était dans la mêlée. Et je m’en voulais d’une certaine façon : peut-être avions-nous sciemment ignoré la part la plus importante de son existence, celle qui avait le plus compté à ses yeux, parce que cela me se mariait guère avec l'image que nous avions de lui ? Il était cet homme modeste, souriant, que j’avais si souvent vu rouler sa cigarette entre ses doigts. Cet homme jovial, un peu lisse, dont personne n'eût soupçonné autre chose que son action auprès de ses malades, qui l'adoraient et parlaient de lui comme du meilleur des médecins.
Qu’est-ce qui nous avait échappé? Je me mettais à regretter de ne pas avoir passé plus de temps avec lui. Sans doute aurais-je beaucoup appris à son contact. Les occasions n'avaient pas manqué, mais j'avais préféré me tourner vers des jeux plus ordinaires.
Tant qu’on est tout près, on ne peut voir la taille véritable d’un homme, parce qu’il n’est pas encore lui-même. Il est en devenir.
Ainsi donc, on ne peut pas mesurer la taille des êtres encore vivants, leur dimension. Et ce n'est pas seulement un effet d'optique comme on serait enclin à le croire. Cela vient après, quand le vivant est devenu trace, empreinte. Alors, oui…
Alors, on se rend compte que ce tremblement en nous ira aussi loin qu’un tremblement de terre, et fera autant de dégâts. C’est comme si on s’éveillait d’un trop long sommeil, on regarde autour de soi, effaré.
Mais... trop tard.
09:23 Publié dans Bréviaire des eaux | Lien permanent | Commentaires (5)
mercredi, 15 mai 2013
Dernier rendez-vous

À sept heures tapantes, comme convenu, la camionnette a débouché du chemin creux. Mordant sur le talus, elle a cahoté en zigzaguant jusqu’à la rivière bordée de neige grise. À cet endroit, elle s’écoule en un labyrinthe de méandres capricieux entre les bosquets et les pierres, de sorte que l’on ne sait jamais de quel côté elle va pencher.
Une portière a claqué dans l’air cristallin.
À présent, la tête de mon oncle apparaissait entre les branchages couverts de givre. Elle disparut derrière une touffe de roseaux pour ressurgir quelques instants plus tard contre le buvard du ciel. On le repérait de loin, avec ses cuissardes de caoutchouc, son gilet de pêche passé sur une chemise de soie bariolée, son chapeau en tweed, version à visières dotée de surcroît d’une paire de protège-oreilles mickeymousiens flottant derrière lui comme des pattes de grizzli agacées par la bise.
Il toussa en arrivant près de moi, ce n’était pas une toux à proprement parler, mais plutôt une espèce de surrection de tout son être, quelque chose d’indicible qui se nouait dans ses profondeurs pour crever à la surface.
– J’ai été obligé de prendre par le bas, expliqua-t-il brièvement, s’appuyant à un robinier à moitié gelé pour reprendre sa respiration.
Il se savait condamné : les médecins, pour une fois, n’avaient laissé planer aucun doute. D’ailleurs, la douleur parlait d’elle-même. Il avait à plusieurs reprises refusé de voir le prêtre, considérant paradoxalement que la religion était une coquetterie incompatible avec son état. Pourtant, lui qui se contentait jusque-là de magazines et des journaux gratis avait commencé à réapprendre les poèmes de son enfance. Il se les repassait dans sa tête, et cela le distrayait des pièges de la mort.
Quelques jours auparavant, il m’avait raconté un rêve au cours duquel il se voyait faire l’ouverture de la pêche avec moi. C’était un rêve étrange, dit-il. D’autant plus étrange que depuis l’annonce de la maladie, il ne rêvait plus, ne gardant du sommeil que cette vague lueur qui rappelle l’encre des nuits sans étoiles. Voilà ce dont il se souvenait : Au bord d’un ponton mangé de lichen et de mousse était amarrée une vieille barque. Malgré qu'elle prenait l’eau de partout, nous étions montés à bord, manquant chavirer. Après avoir vainement cherché à la vider à l’aide d’un seau troué, nous l'avions détachée, la regardant s’éloigner pesamment dans la brume matinale. Puis nous nous étions empoignés par le revers de nos vestes, mais il n’était pas clair si c’était une lutte ou une accolade – quelque chose de réconfortant, tint-il à préciser. Un peu plus tard, nous étions tombés sur un écriteau qui annonçait péremptoirement : « Pêche interdite aux plus de quatre-vingt-huit ans ». Cela l’avait réconforté.
Je le questionnai encore sur la façon dont tout cela s’était terminé.
– Je n’en sais rien, figure-toi… Et même ce que j’ai pu entrevoir… est-ce le songe d’un dormeur ou un rêve éveillé ? Qu’importe, puisque rêver c’est encore vivre. Une même vie m’anime et pourtant je ne la possède pas. Elle est ma conscience, elle passe ainsi que l’eau dans les porosités d’un galet, y demeure quelques instants, puis s’enfuit ailleurs.
C’était beaucoup de mots pour un taiseux.
Il se laissa choir sur un tabouret pliable et commença à s’affairer en silence, sortant un à un les hamçons de sa boîte à leurres. Au bout d’un temps qui me parut, à moi, infini, il brandit un bocal de vers fraîchement exhumés de son jardin. Les bestioles roses se tortillaient désespérément dans le verre obturé, un bel appât, et exactement de la bonne taille. Moi qui suis habituellement assez peu sensible au bruit, j’entendais très distinctement chaque râle, cela se mêlait au couinement des caoutchoucs, au heurt métallique des boîtes, au cliquetis des cannes télescopiques... c’était quelque chose d’affreux et, c’est pourtant étrange quand on y songe... d’embarrassant… Lui continuait à trier son matériel, sans un mot. Il semblait ignorer ce chuintement que produisaient ses bronches, se concentrant sur ce qu'il faisait, avec de petits mouvements parcimonieux. Chaque souffle était devenu trop précieux pour être gaspillé.
Car il redoutait d’étouffer, et cette pensée ne le lâchait plus. Oui, tout sauf étouffer, partir dans cette noyade sans fin, cet abominable cri de toutes les fibres. Il avait chargé un ami de le pourvoir du nécessaire en vue de ce moment pénible, désirant que cela se passe ailleurs que dans l’une de ces salles où votre dernier air a été souillé d’odeurs méphitiques. Ensemble, ils avaient préparé le poison dans une petite fiole translucide.
Tout cela va de soi et ne devrait pas étonner.
Nous jetâmes de petits morceaux de pain au milieu des pastilles d’argent qui coulaient sous l’herbe retroussée, déployâmes nos cannes. On percevait le doux chuintement d’une flûte à sortilèges. Un couple de hérons blancs et violets est venu effectuer un petit vol de reconnaissance au-dessus de nos têtes, histoire de se rendre compte de quoi il retournait. Nous les avons regardés passer sans cacher notre contentement. Chaque battement de notre cœur peut susciter une force encore endormie.
Sans que rien ne fut rajouté, il mit à tremper dans le courant deux bouteilles préalablement attachées par le goulot à une branche de la berge. Aussitôt, la rivière referma son poing sur elles – la ficelle tendue se tortillait en tous sens, mais nous savions d’expérience qu’elle ne lâcherait pas. L’eau était glaciale et la journée s’annonçait glorieuse.
Alors, sans nous hâter, nous avons lancé les lignes.
22:31 Publié dans Bréviaire des eaux | Lien permanent | Commentaires (2)
vendredi, 20 février 2009
Mon frère et moi
J'ai grandi aux abords d’une rivière, près d’une cascade où les truites arc-en-ciel venaient nous danser avant l’orage leur ballet des origines ! Dès l’âge de huit, neuf, dix ans, j’ai passé le printemps, l’été, toute une partie de l’automne au bord de l’eau coureuse. Toutefois, en dépit d’un émerveillement constant, ma curiosité n’a pas véritablement su s’éveiller à la pêche. Une certaine maladresse dans le geste m’en éloigna sans doute. Et puis, il y avait mon frère Joseph, surtout, qui y excellait avec une habileté que lui enviaient les pêcheurs confirmés. Ceux-là le suivaient en douce ou cherchaient à se lier d’amitié avec lui dans l’espoir d’éventer ses secrets. Quant aux autres, les pêcheurs du dimanche, les stationneurs au petit pied, ceux dont nous disions qu’ils n’eussent pas trouvé de frites dans l’huile, ils l’épiaient derrière les croisées, la mine déconfite, lorsqu’il traversait nonchalamment le village, canne en main, sac en bandoulière, sans se douter le moins du monde de la provocation que constitue en soi une musette emplie de bêtes visqueuses et froides arrachées d’un geste précis au bouillonnement moussu d‘un rapide ou d’une chute (et c'est ainsi qu'une ombre sautillante le suivait en permanence, cachée derrière les murets, les robiniers, se fondant dans la verte chevelure des saules).
Comment faisait-il? Nul ne connaissait les coins poissonneux ni ne lisait le courant comme lui. Personne pour pêcher les bordures de rochers, pour lancer de façon aussi élégante, pour récupérer puis relancer dans le même mouvement, en artiste consommé. C'était un sepctacle à la fois très beau et qui donnait l'impression d'une présence, d'une adéquation presque vertigineuse. Disons le tout net: il y avait quelque chose de stupéfiant à le voir opérer, contredisant le caractère aléatoire de la pêche qui reflète les bonnes et les mauvaises fortunes de la vie. Car Joseph faisait mouche à chaque coup. Il y avait comme une sorte d'attirance magnétique au bout de ses doigts, une vraie sorcellerie! Même après avoir passé des après-midi entières à l’observer, à essayer de comprendre, je garde l’impression que son art ne découlait pas d’une maîtrise consciente ou consécutive à la découverte de quelque règle empirique, mais relevait du pur instinct. Non, il ne faisait pas partie de ces gens qui usent leurs forces en longues préparations et en savants calculs.
Dès avant l’aube, précédant le chant du coq, il s’échappait dans l’air nacré, pailleté d’or et de rosée, à peine vêtu, tout juste éveillé, couvert déjà par le regard scrutateur de quelque voisin matinal. Cette concupiscence, c’était le signe d’une journée qui s’annonçait laborieuse pour tous. D’abord, Joseph se mettait à bêcher pour arracher à la terre une poignée de lombrics qu’il enfermait dans de gros bocaux à confiture, sales et ébréchés (mais ce travail de prospection minière laissait forcément des traces: il y avait partout autour de la maison des trous dans lesquels nous trébuchions à tout instant). Ensuite, il disparaissait quelques instants dans la remise pour en retirer son attirail de pêche: la canne, les fils, l’épuisette aux mailles déchirées. En somnambule, il enfourchait sa bicyclette sur laquelle on le voyait se fondre, silhouette indécise, dans la demi-obscurité couverte de légers voiles ocre et bleu.
Qu’on ne s’y méprenne ! Invariablement, nous trouvions à notre lever, bien sagement alignées sur le zinc de l’évier, les victimes bleuies de ses meurtres et de ses rapines, yeux globuleux, plaies imprégnées de sang à vif. Ses prises, innombrables, étaient là, froides et leur présence imprimait quelque chose d’à la fois familier et trouble dans notre cuisine. C’était une nature morte d’une beauté étonnante, qui nous attirait en même temps qu’elle nous pétrifiait. Comme il se doit, on attendait que toute la famille se trouvât réunie pour vider le poisson, tâche dévolue à notre mère qui commençait par inciser à la base de la nageoire caudale ; s’étant essuyé le front du revers du coude, elle laissait ensuite courir la lame effilée jusqu’à hauteur des branchies avant d’introduire un doigt, puis deux, dans la fente ainsi pratiquée, sectionnant non sans délicatesse dans la cavité froide, extirpant un rein, un agglomérat spongieux, quelques semblants d’intestins roses ou blanchâtres.
Inutile d’ajouter que nous étions incontestablement fiers des terribles exploits de notre prestidigitateur – fiers de façon presque scandaleuse. Pour ma part, je ne demandais qu’à le suivre dans ses prouesses, mais malgré ses explications (que je livrerais volontiers dans l’espoir qu’elles puissent être utiles à quelqu’un), impossible de progresser. Or donc, Joseph avait établi à l'usage de ses proches une sorte programme d’apprentissage progressif qui retraçait quelques principes essentiels de la pêche en rivière. Il était impératif, selon ses vues, de commencer par le plus difficile, c’est-à-dire la truite elle-même, car qui maîtrise la truite sera capable de capturer par la suite n’importe quelle autre espèce de poisson. C'était vite dit. Dans les faits, je n'ai vu personne lui arriver à la cheville, malgré les heures passées à expliquer les nuances et les subtilités de la rivière.
À chaque saison, la table familiale regorgeait de fuseaux argentins remontés de ces lieux interlopes que sont les méandres et les tourbillons. On en troquait contre des légumes frais, on en offrait, on nourrissait les chats de leurs chairs pâles, au point que personne dans notre entourage ne savait plus à quelle sauce les apprêter. Mon frère n’assistait jamais lui-même à toutes ces transactions, commérages et échanges de recettes. Je crois que ça l’atterrait plutôt. Les salmonidés lui tombaient des mains, soit, il n’en tirait nul orgueil, mais nous nous demandions toujours par quel miracle notre petite rivière pouvait receler tant de ces corps élastiques, étincelants et disponibles – qui se nourrissaient de quoi ? Par la force des choses, j’ai donc dû me rabattre sur un art moins glissant, et le hasard voulut que ce fût celui de la capture des mots, pas si faciles non plus à lever sous les algues et les pierres au bout de la ligne plombée.
Bréviaire des eaux, extrait, in Verrières, n°6, juin 2001
09:20 Publié dans Bréviaire des eaux | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, pêche, truite, rivière
jeudi, 19 février 2009
Trouver la truite
J'ai toujours été un piètre pêcheur. Un jour, cependant, à rebours de tout bon sens, mon frère décida que je pouvais progresser. Il m'offrait de me prendre en main. Il m'avait fixé rendez-vous non loin de chez nous, au pied des ruines d'un moulin désaffecté qui menaçait à tout instant de s'effondrer. L'aube luttait avec le brouillard, qui s'étendait encore par bancs opalescents sur la campagne environnante. Je parvins près de ce bras de rivière où le courant ralentit, hésite, offrant une vue plongeante sur les algues qui tapissent le fond. Tout était à la fois léger et solide, grave et plaisant. Mon frère était déjà là, il m'attendait depuis un moment, sans impatience. Mon instruction devait se dérouler selon un cheminement simple pour lui, extrêmement subtil et incompréhensible pour moi. Selon lui, il s'agissait seulement de fonder la relation que nous entretenons spontanément avec notre environnement : le vent, la température de l’air et de l’eau, les odeurs qui flottent, s'entremêlent au vent, les variations et les jeux de la lumière, qui prend près de la surface d’un courant une calorie spéciale, insoupçonnée, toutes ces choses nous parlent un langage qui est celui de la vie même. Pour ce qui était des truites, il lui semblait tout d'abord primordial que je me débarrasse de quelques illusions, ce qui est plus difficile qu’on ne le croit. Les illusions ! Prenons par exemple celle, tenace, qui consiste à croire dur comme fer que le sapiens sapiens est l’animal le plus évolué de la planète, et donc le plus éclairé, adapté, persévérant, ingénieux, etc. À ce régime, vos chances de lever un jour au bout de la ligne transparente un salmonidé quelconque équivalent pour ainsi dire à zéro. Car la truite évolue dans ce qu'on peut considérer comme un miroir déformant, où notre reflet se consume à chaque seconde, se décomposant en mille petits éclats désordonnés. C'est un monde ultra-sensible, extra-lucide, hyper-pénétrant.
Il résulte de tout cela qu'il faut se faire une règle de se tenir à contre-jour, quoi qu’il advienne, et bouger le moins possible afin de ne pas éveiller les soupçons de la belle fugitive, car elle est comme nulle autre sensible au bruit, et d'ailleurs rien ne l’effraie tant qu'une ombre portée. D’une intelligence fine et délurée, elle aura tôt fait d’établir le rapport avec un de ces bipèdes voraces qui polluent son environnement et n’en ont qu’après sa chair fraîche. Disons, pour faire court, que pour les créatures qui vivent à la frontière qui sépare l'air et l'eau, c'est surtout la lumière qui donne sens à l'ondulation des algues, aux battements toujours particuliers du courant sur les berges, à la mobilité. C'est une grande pulsion qui emporte tout. Ici, le monde a sa richesse et son poids, et sa logique pourtant ressemble à une absence totale de logique. C'est le règne de la magie et de l'indéchiffrable. Mon frère n'était pas superstitieux, il ne croyait pas au surnaturel, ou plutôt il y faisait entrer tout le naturel dont il était capable, à chaque instant. Quand il trouvait une truite à trois ovaires, il ne s'en étonnait pas: une truite à deux ovaires est déjà, si l'on y songe, une énigme suffisante. Dans la vie, tout n'est-il pas question de dosage, discrétion, modestie?
Bon, voilà, si vous avez tout compris, il ne vous reste plus qu'à appâter... Après avoir entre-aperçu un bref reflet argenté qui se confond avec un reflet du soleil, vous venez donc de lancer, et la mouche flotte à quatre mètres de la berge, s'éloignant lentement au gré du courant. Parvenu à ce point, efforcez-vous de retenir votre souffle, même si un léger voile devait obscurcir votre vision. En dépit de la crampe qui s’empare de votre poignet, surtout, ne bougez plus! Cela vaut mieux que de l’effrayer. Armez-vous de patience, et plein de dévotion pour l‘objet de vos attentes, tel un mystique dans l’expectative de la révélation, laissez-vous aller à rêver, efforcez-vous de voir au-delà des apparences. Imaginez-la, essayez de vous projeter dans le vide des apparences... De toute façon, peut-être que vous la regardez déjà depuis un certain temps sans avoir réalisé que c’était elle qui vous chatouillait dans sa princière nudité sous les dessous de nylon de la rivière. Car s’il y a loin de la truite à l’oeil (deux, trois mètres tout au plus), le chemin qui sépare votre rétine de la pensée se compte, lui, en années-lumière d’axones et de synapses, autant de relais qu‘il vous faudra franchir par la force de votre volonté. Par conséquent, ne désespérez pas si vous n’apercevez rien avant longtemps. C'est bien normal. Ça viendra. C’est déjà là.
Bréviaire de eaux, extrait, in Verrières, n°6, juin 2001
15:30 Publié dans Bréviaire des eaux | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, pêche, truite