mercredi, 20 novembre 2013
Le train dans la malle
Cet automne, comme je passais une semaine chez mes vieux parents, ma mère me fit remarquer qu’il y avait toujours cette malle au grenier, qui m’appartenait plus ou moins, et qu’elle me priait de débarrasser pendant les vacances. Depuis quelque temps, disait-elle, secondée par mon père qui résistait pourtant de toutes ses forces, elle avait commencé à mettre de l’ordre dans la maison.
Les journées qui suivirent, je tournai autour de la porte du grenier attenant à ma chambre d’enfant. C’était une porte en bois blanc qui obligeait à se courber profondément pour accéder à la soupente tellement elle était basse. Impossible de pousser ce loquet. Je trouvais toutes sortes de dérivatifs : le jardin, les amis qu’il fallait visiter de toute urgence, le défilé incessant des cousins qui ont tant compté dans ma jeunesse et que je revois toujours avec plaisir.
Je fuyais, mais ce que je fuyais, je ne le savais pas.
Ma mère revenait à la charge, c’en devenait inconvenant. N’en pouvant plus, je cédai.
Lorsque la porte s’ouvrit, il me fallut plusieurs minutes pour m’habituer à la pénombre du grenier qui me parut du coup beaucoup plus étroit que ce que j’avais gardé en mémoire. Je fis un pas, puis un autre, m’arrêtai à un endroit où le plancher craquait vraiment très sinistrement. Il me semblait baigner dans la chaude atmosphère d’une serre. Une chauve-souris me frôla de son aile vive ; comme j’aurais aimé lui ressembler, si légère, saisissant des oscillations invisibles, prévoyant les remous d’air à la façon d’un sismographe inconscient !
Le coffre était bien là où je l’avais imaginé, tout au fond, coincé sous les poutres qui descendaient jusqu’au sol.
Lorsque je soulevai le couvercle, je ne vis rien d’abord, tant la poussière volait autour de moi, s’élevant en tourbillons mordorés vers le puits de lumière formé par l’œil-de-bœuf.
Je plongeai mes mains au fond de l’espace noir, mais elles ne rencontraient que des cahiers moisis, des monceaux de papier poisseux qui s’effritaient quand j’essayais de les extraire de ce tas humide et légèrement dégoûtant. Je croyais aller à la rencontre de mes souvenirs, je ne trouvais que pourriture, décomposition.
Soudain, mes doigts butèrent sur quelque chose de dur. Non, je ne me trompais pas. Un angle, un arrondi, des crochets. C’était bien lui... Je le ramenai délicatement à moi, le soulevant par un bout, à la verticale. Il résistait, c’était comme s’il avait voulu rester là où je l’avais oublié pendant tant d’années.
Mon train. Mon bon vieux train.
Un de ces trains en bois, à la peinture si écaillée qu’elle commença à s’effriter lorsque je l’enserrai pour bien maintenir les wagons accrochés les uns aux autres.
Le train de mes rêves.
Aux alentours de mes cinq, six ans, je faisais un rêve récurrent et tenace qui me remplissait de terreur.
Voilà ce dont il s’agissait.
Je marche à travers une campagne désertique, au bout de laquelle, invariablement, se dresse un pont qui enjambe une vallée sombre. Ce pont, pourtant relativement modeste, comporte deux tabliers accolés: chacun d’eux est composé d’une épaisse dalle supportée par des poutres en acier liées entre elles par des entretoises perpendiculaires. Je le traverse sans me retourner, je chemine prudemment entre les treillis de protection qui bordent – des deux côtés – les voies électrifiées.
Je l’entends, il y a, quelque part, perdu dans un segment d’espace-temps indéfini, un train qui roule, qui roule, roule de plus en plus vite, s’approchant dans un fracas indescriptible. À mesure que j’avance, le danger prend forme et la peur me colle au ventre, éclate comme un abcès, déborde. Je supporte vaillamment cette sensation affreuse parce que je suis seul et que cela rend la chose moins pénible. La solitude a ses avantages, après tout…
Et soudain, le train est là.
Il me fonce dessus.
En toute logique, je m’anéantis – je m’anéantis et revis aussitôt.
Un blanc. Et je me réveille en sueur.
Je me lève, je descends à la cuisine, mange un morceau de pain. J’essaie de reprendre pied dans une nouvelle journée.
C’est ainsi que je vis jour après jour, revivant et m’anéantissant dans des cycles sans fin, comme si tout pouvait arriver, à n’importe quel moment.
Maintenant, ce sont bien entendu d’autres trains qui foncent sur les voies de ma vie (qui n’est jamais rectiligne comme dans le rêve!), et je n’y prends pas toujours garde. Maintenant, j’ai parsemé les gares de malles qui contiennent toutes sortes de jouets plus ou moins dangereux, plus ou moins inoffensifs et bienfaisants. Mais qu’importe!
Le soir même, j’ôtai la poussière incrustée dans le vieux bois et le nettoyai avec un chiffon humide. Je redressai encore une vis rouillée qui sortait du ventre de la locomotive. Mon père m’observait d’un air dubitatif – il se trouvait très loin déjà, embarqué dans des rêveries autrement plus mélancoliques. Je n’avais pas fini qu'il dormait dans son fauteuil.
Puis, j’empaquetai le tout, précieusement.
Notre humanité brille dans l’enfance qui seule la sauve des excédents de réalité qui nous blessent sans qu’il soit toujours possible pourtant d’échapper à ce laminoir.
Sur la banquette du compartiment qui me ramenait chez moi, je posai le sac qui contenait le vieux train. Sous le regard vaguement amusé de mes voisins, je le pris sur les genoux, comme on berce un enfant convalescent.
À mon retour, je l’offrirais à mes deux fillettes.
J’imaginais déjà leur joie, j’entendais les mille et une histoires qui sortiraient de leur imagination, s’enroulant comme des guirlandes colorées autour de ma nostalgie.
Par avance, je savourais cet instant.
12:09 Publié dans Bréviaire des eaux | Lien permanent | Commentaires (0)

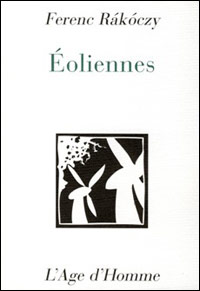
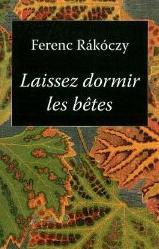





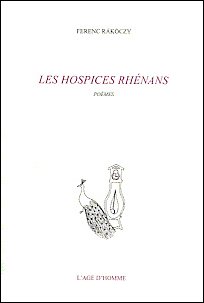
Les commentaires sont fermés.