samedi, 06 décembre 2008
Nicolas Bertholet expose sa "période américaine" à la Galerie du Tilleul, à Champtauroz (Suisse, canton de Vaud), du 6 au 21 décembre 2008
 La peinture est un autre monde. Elle prolonge le nôtre, elle en est comme une ramification, un écho, une nouvelle strate et, cependant, elle obéit à des règles et à des injonctions particulières. Et c’est aussi un monde où l’on cherche à rejoindre l’autre, instantanément, d’un seul saut à pieds joints, et un monde qui se préserve, se love en ses plis – un monde qui sait garder son mystère, avec ses énigmes, ses aboutissements, ses réussites et ses échecs. Tout se passe comme si la communication la plus efficace dépendait de ce mystère, de l’opacité farouche qui continue à couver, même lorsque se révèle le maximum de franchise et de clarté. Ce phénomène étrange parce qu’irréductible au sens, c’est tout simplement la beauté, la beauté qui, bien entendu, relève d’une construction singulière de la sensibilité propre à chacun et, au-delà, de la sensibilité d’un milieu, d’une époque. Elle est la même pour tous et elle n’est la même pour personne.
La peinture est un autre monde. Elle prolonge le nôtre, elle en est comme une ramification, un écho, une nouvelle strate et, cependant, elle obéit à des règles et à des injonctions particulières. Et c’est aussi un monde où l’on cherche à rejoindre l’autre, instantanément, d’un seul saut à pieds joints, et un monde qui se préserve, se love en ses plis – un monde qui sait garder son mystère, avec ses énigmes, ses aboutissements, ses réussites et ses échecs. Tout se passe comme si la communication la plus efficace dépendait de ce mystère, de l’opacité farouche qui continue à couver, même lorsque se révèle le maximum de franchise et de clarté. Ce phénomène étrange parce qu’irréductible au sens, c’est tout simplement la beauté, la beauté qui, bien entendu, relève d’une construction singulière de la sensibilité propre à chacun et, au-delà, de la sensibilité d’un milieu, d’une époque. Elle est la même pour tous et elle n’est la même pour personne.
Il faut ici ouvrir une parenthèse. La plupart des approches, avant d’essayer de dire ce qu’est la beauté plastique, disent ce qu’elle n’est pas. Le point de vue discriminatif, qui est surtout celui de la critique d’art, a certes ses avantages puisqu’il rassure à bon compte sur la permanence du savoir. Analyser les moyens mis en oeuvre dans telle ou telle peinture est un jeu somme toute assez anodin pour qu’on en généralise l’usage, car il a le grand avantage de délester de son poids celui qui le pratique. Mais, devant la force poétique d’une œuvre authentique, on se rend vite compte que les critères esthétiques épuisent leur force et leur pouvoir, ne parvenant pas à nous venir en aide d’une quelconque manière pour ce qui est de comprendre les raisons de notre ravissement devant cette surface en apparence si plane et pourtant si chargée, parce qu’elle semble traversée d’incessantes métamorphoses. Là, point de mots, moins encore de raisonnements, quelque chose d’inconnu s’est organisé d’une telle façon que le résultat échappe à toute forme d’appréciation. S’il faut renoncer à expliquer l’essence de la beauté (qui rejoint les grandes énigmes desquelles toute notre vie découle), il est possible, en revanche, de dire à quoi on la reconnaît. Non seulement cela est possible, mais c’est indispensable dans le cas où il s’agit de juger la qualité d’une œuvre picturale.
Là encore, pas de solution simple cependant : c’est à chacun qu’il échoit de répondre, en son nom, à cette brûlante question. Disposition à laquelle bien peu sont prêts en vérité. Ainsi donc, si je veux me montrer parfaitement loyal, je ne pourrai faire part ici que de mon sentiment personnel, de l’écheveau complexe d’émotions que suscitent en mon for intérieur les toiles de Nicolas Bertholet. Point de vue tenu en laisse par la plus totale subjectivité, il va de soi, et qui, de surcroît, peine à trouver son expression en raison de l’indigence des mots. Qu’importe ! En tout état de cause, il n’y en aura pas d’autre, malgré toutes les illusions que nous aimerions déployer à ce sujet, et il en va de même pour chacun de nous. C’est peu, assurément. Et c’est beaucoup.
◊
Parvenu à ce point, j’aimerais évoquer, pour ceux qui ne connaissent pas sa démarche, la progression inattendue qu’a subie la peinture de Bertholet ces trois dernières années, spécialement durant son séjour américain – oui, un véritable saut maturatif. Et ce saut est caractérisé par une force, une vigueur sauvage, quelque chose de viscéral, d’élémentaire. Comment fait-il, quel est son secret ? Après s’être ancré jusqu’à récemment dans un agencement très massif et principalement rectangulaire de l’espace, son travail aujourd’hui s’inscrit dans une énergie nouvelle, qui tolère le chaos, la perturbation et, paradoxalement, un trouble enchanté, une sérénité chargée d’attentes. Cela commence par l’apparition de sortes de signaux qui flottent dans l’espace plastique comme autant d’animalcules psychiques, non sans légèreté, de minuscules et fragiles matrices désarticulées, constamment déchiquetées (qui de près font penser à des ovules), ou encore des filaments d’autant plus précieux qu’hésitants, parfois terminés par une houppette, une germination, un faisceau de pistils, des espèces de mille-pattes hypothétiques et insouciants. Par moments, ne dirait-on pas un plancton traversé de méduses aux dimensions d’une mer qui serait le monde ? Ce tournoiement de bestioles bizarroïdes dessine un ici qui respire tout en expirant l’ailleurs. Débris, résidus d’un imaginaire ouvert, arachnéen, en train de se chercher en permanence. Ce sont des traces, au sens étymologique du mot. Ceci apparaît de manière assez évidente dans un grand nombre de toiles, comme une conscience aiguë de l’instabilité des signes.
La trace, en effet, présuppose le passage qui est sa cause et dont elle est l’effet. C’est une sorte de témoignage, si l’on veut, le témoignage d’un contact essentiel entre la matière inorganique et le vivant, et donc, toujours, une substance en sursis, prête à s’effacer d’un instant à l’autre. Oui, une substance marquée au sceau de la plus grande des fragilités. Ces traces, on pourrait les nommer des intermédiaires.Néanmoins, si l’artiste utilise davantage d’intermédiaires, ces intermédiaires sont moins organisés, moins codifiés et hiérarchisés qu’ils n’ont pu l’être jusqu’ici. Bertholet use de l’instrument le plus simple : la main qui jette la couleur, rejette, reprend, repousse, divise, griffe, lacère, en gestes tantôt souples, amples, tantôt saccadés, revient sur ses pas, caresse la toile (presque comme dans un lavis, engendrant de grosses taches baveuses), le trait qui fouille cet antre blanc d’où tout peut surgir, où il faut tout chercher, les proches préférés aux lointains, le dedans au dehors, le balbutiement aux motifs trop définitivement arrêtés. Ces motifs, ces unités défaites, ces espèces d’indices d’une motivation à la fois obscure et évidente, on peut y voir encore des balises, des sortes de signaux cabalistiques qui s’aimantent autour d’un mouvement, car ce dont il s’agit avant tout, c’est de rompre l’inertie, de sortir du statique. Mouvement comme désobéissance et comme fureur, comme remaniement et métaphore d’un psychisme qui s’épanche dans la fluidité et l’élaboration recombinative... Quelque chose demeure pourtant de l’ancienne manière d’organiser l’espace visuel : la capacité de former une unité caractérisée par sa « gratuité », c’est-à-dire ne visant pas à raconter une histoire ni à transmettre une information, mais recherchant un effet poétique intense, quasiment immédiat. À telle enseigne que les images, une fois qu’on a fermé les yeux, continuent à danser longtemps sur le fond de la rétine, pareilles à de prodigieux éclats d’astres. En raison de leur pouvoir attractif, ces éclats cessent d’être impénétrables, l’oeil embrassant d’un coup de grands ensembles, générant une incroyable gravité, dans tous les sens du mot – cela peut parfois s’effectuer en un éclair, d’autres fois par un lent et perspicace approfondissement, à travers le déploiement de rythmes lancinants, prenant même occasionnellement le risque de se laisser gouverner par le hasard. On ne peut que se sentir complice d’un tel bonheur, d’une telle fidélité à soi-même.
◊
Un autre mérite que j’aimerais relever dans cette peinture, c’est sa simplicité. Elle ose se mettre en danger, ne pas embellir. Par exemple, en utilisant bien souvent le flou, l’indétermination, le tremblé. Un grand nombre de toiles sont ainsi comparables à un tourbillon de rivière qui enroulerait soi-même tout ce que son mouvement n’a pas rejeté sur les bords ; dans ces cas, une fusion constante s’opère entre la profondeur et la surface, ce qui provoque la formation de zones de flottement qui captent, enchantent le regard. L’énergie provient alors d’une collaboration des forces en interactions ou, mieux : d’une poussée synergique. La forme, la couleur et la ligne s’expriment dans des rapports pour ainsi dire naturels et paisibles, vibrant immobiles entre deux eaux. Sans doute cela tient-il en grande partie aux fonds, toujours soigneusement travaillés, même quand le blanc outrancièrement domine. Parce qu’ici on a su abandonner toute forme de défense contre soi-même, la lumière est toujours de l’autre côté de la nuit, comme celle, plus éblouissante, que l’on aperçoit dans les rêves et où surgissent tant d’événements du visuel... En quoi l’oeuvre bertholésienne rejoint la définition de la peinture abstraite en tant qu’images autonomes qui ne renvoient qu’à elles-mêmes, rompant avec le monde des apparences, révélant l’existence de réalités jusqu’alors invisibles, impénétrables. Elle se porte inlassablement de l’autre côté.
Un sentiment de bien-être s’y propage, avec le vide pour complice. En effet, je crois qu’il ne faut pas sous-estimer la capacité créative du vide : celui-ci pousse à retourner à la matière brute, à trouver une trame énergétique de haute tension mais également de basse tension, d’où peut découler une certaine détente, un véritable apaisement même. Une harmonie se constitue dans le brouhaha des couleurs, venant nous rappeler bien à propos que Nicolas Bertholet est attaché plus que n’importe qui à la musique et particulièrement au jazz contemporain. Le temps musical porte cette peinture qui ne résiste pas à la dérive. Pas d’homme plus riche sur terre que celui qui est ainsi habité : il est un enfant heureux dans ses jeux et ses songeries.
◊
Enfin, disons encore qu’il règne sur l’univers de Nicolas Bertholet une multiplicité si extraordinaire qu’elle a le pouvoir de nous changer, de transformer notre regard sur les choses. Elle motive une expression de gratitude envers la vie et le vivant qui nous entoure. Et, par cette magie, notre perception retrouve la capacité d’entrer en contact avec notre intériorité, dans la joie et le bien-être. Témoigner de la joie et du bonheur n’est pas ignorer la souffrance ni la déréliction. D’une certaine manière, se tenir devant ce qui s’exprime ici, c’est avoir trouvé un endroit où l’on peut habiter sans se satisfaire d’y être et sans curiosité malséante, consentant à l’allégresse et au silence de la rencontre, à cette innocence qui enlève tout. C’est un rendez-vous avec l’origine de la lumière et, partant, avec nos propres origines. Aux confins de ce lieu fragile, rien ne me sépare plus de moi-même : j’ai le droit de regarder sans arrière-pensée. De sentir. De goûter. Nous sommes tous en perdition. Nous n’avons seulement pas la force de nous l’avouer. L’artiste est le seul dans la cité à jouir de ce privilège sans partage : il conduit les autres par des chemins indicibles, hors de la parole qui si souvent blesse, domine, cherche à terrasser. À sa façon, il soigne, guérit. Guérir revient à vivre dans le déroulement du temps, consentir à discerner ce qui nous fait vivre au cœur de ce qui, en nous, y fait obstacle, laissant ressurgir le désir que soutient et autorise la présence d’un ami. C’est en cela que Nicolas Bertholet atteint quelque chose de rare. S’aventurant au cœur de l’inconnu, se dédoublant sans effort ni contrainte, mais pour lui-même, sans nous imposer les affres de ce dédoublement, sans avoir l’air même d’y toucher, il a su concevoir des images amples, accueillantes et sonores qui nous parlent de l’espoir, du cosmos, de la fraternité. C’est sa façon à lui de garder son secret. Soyons-lui reconnaissants de tant de sagacité.
09:08 Publié dans Nicolas Bertholet, peintre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : peinture, art, art plastique, critique d'art

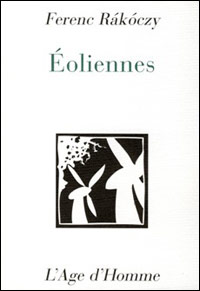
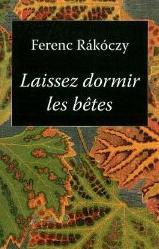





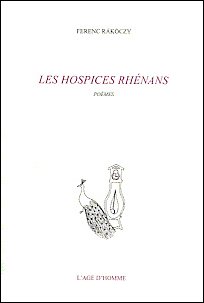
Commentaires
ça donne envie de découvrir ce peintre. son site est d'ailleurs très beau et ça déménage pas mal!
Écrit par : bobmoore | dimanche, 15 février 2009
Les commentaires sont fermés.