jeudi, 04 décembre 2008
Attraper l’énergie du monde
Entretien avec Nicolas Bertholet, artiste plasticien
 Ferenc Rákóczy – Vous revenez de Boston et vous avez décidé d’exposer vos grands et moyens formats à la Galerie du Tilleul à Champtauroz (Suisse, canton de Vaud), du 6 au 21 décembre 2008. Parlez-nous de la genèse de ces toiles.
Ferenc Rákóczy – Vous revenez de Boston et vous avez décidé d’exposer vos grands et moyens formats à la Galerie du Tilleul à Champtauroz (Suisse, canton de Vaud), du 6 au 21 décembre 2008. Parlez-nous de la genèse de ces toiles.
Nicolas Bertholet – C’est peut-être un peu trivial, mais la question des formats est uniquement d’ordre logistique. Par manque de place, à Boston, j’ai travaillé sur toiles non montées. J’ai pu, dans un espace plus petit, travailler sur des formats beaucoup plus grands (au point que certaines peintures ont été effectuées par segments, roulant et déroulant les rouleaux de toile sur le sol). Le fait d’avoir moins de place m’a paradoxalement permis de passer à des formats plus conséquents. En effet, à cause de l’exiguïté des lieux, je n’aurais pas pu stocker des toiles de moyen format montées. J’ai donc opté pour des toiles non montées et les formats ont « grandi » d’eux-mêmes (c’est un peu ce dont je rêvais aussi, mais bon…). Pour ce qui est des motifs, certains pointaient déjà derrière les carrés et les rectangles. Le rectangle, c’est tout de même beaucoup plus rassurant. L’explosion de ce cadre s’est faite petit à petit, peut-être aussi grâce à l’éloignement géographique et au « retour à la caverne » qu’a pu être Boston dans les premiers mois.
F.R. – Oui, ce quasi abandon du rectangle qui vous définissait jusqu’ici est tout à fait surprenant... Il y a aussi un glissement vers quelque chose d’hiéroglyphique et, en même temps, une délivrance, un élan vers le mal léché, le tremblé, le précaire. Tous ces aspects témoignent, me semble-t-il, de la volonté d’un retour au geste primitif.
N.B. – C’est lorsque je ne réfléchis plus que j’ai l’impression que ces « hiéroglyphes » tiennent et ont une énergie suffisante. Cela ne va pourtant pas de soi. Je tiens des carnets où je dessine (un peu compulsivement) les formes qui m’intéressent jusqu’à être en mesure de ne plus penser lorsque je les pose sur la toile. Un peu comme le dit un percussionniste avec qui Sylvie Bourban, mon épouse, a travaillé : « Si tu dois penser à ce que tu fais, tu laisses passer le moment (c’est un peu ce que j’ai pu vivre avec les claquettes). Tu dois pouvoir être en mesure de faire les choses sans vraiment penser à CE que tu fais. Il faut être à un niveau différent. » Plus dans la perception globale, contextuelle, que dans le geste lui-même… Si tu es obligé de réfléchir, tu n’es jamais dans l’instant présent, tu ne fais que le suivre avec un temps de retard). Ces hiéroglyphes sont également une tentative d’accéder à un monde mouvant. Une espèce de poétique de l’abstraction (même si elle finit par tendre vers la figuration). Un peu comme le développement d’une signalétique, d’un langage symbolique propre. L’avantage des symboles, c’est qu’ils détiennent à la fois une force graphique et une force sémantique. Le langage symbolique me semble moins attaché à une temporalité. Pas besoin d’ordonner l’histoire comme dans une bande dessinée.
F.R. – Le temps, le rythme sont des notions qui paraissent revêtir une grande importance à vos yeux. Pourrait-on dire, à cet égard, que vous traduisez une problématique très contemporaine, celle de l’accélération de la vie, aussi bien réelle que fantasmatique (comme c’est le cas dans le jeu vidéo, par exemple, ou encore dans le monde de l’art), avec les énormes transbordements énergétiques que cela suppose. Comment vous situez-vous par rapport à ce qui se fait aujourd’hui ? Quelles ont été vos influences ?
N.B. – Il y a d’abord mon amour de la musique, le jazz, le free jazz, les successions de rythmes, etc. Plus que l’accélération, j’ai l’impression que c’est le bombardement incessant d’informations qui me fascine. Dans une ville comme New York, l’information est constante. Il y a une surenchère de messages, aucune gradation, aucune indication quant à la valeur même de ces messages. Juste un flux (flot ?) constant. Je trouve cela absolument fascinant. New York est un endroit incroyable. Une sorte de jungle visuelle complètement anarchique, désordonnée, parfois ultra agressive, rapide, fulgurante. Je n’ai pas l’impression de faire de la peinture « d’aujourd’hui ». J’ai les influences de quelqu’un qui a vécu son adolescence avec Lichtenstein et Basquiat (et l’explosion visuelle qu’ils représentent), tout en étant culturellement beaucoup plus proche de Rothko et Twombly (la culture gréco-latine, la « vieille Europe »). Les gens que j’aime actuellement sont finalement assez éloignés de ce que je fais (mis à part Twombly, quoi qu’il appartienne à une autre génération) : Opie (fascination pour l’efficacité dans le signe, la clarté, la force visuelle), Viola (mais il reste extrêmement classique… ou du moins très influencé par un certain classicisme), la dernière installation de Pipilotti Rist au Moma, Olafur Eliasson, ou encore certains artistes japonais tels que Misaki Kawai, pour le côté ludique et ironique. Mark Dion pour la mise en abîme des cabinets de curiosité. Richter pour la capacité de mener de front de multiples genres. Parmi les gens de la génération précédente, ce serait plutôt l’expressionnisme abstrait, Rothko, Kline, etc. Et encore Giacometti, les oiseaux de Braque. Puis Sisley, pour la neige…
F.R. – Un des dénominateurs communs de tous ces noms que vous mettez en avant me semble être la notion de perfectibilité. Ce sont des artistes qui ont cherché en permanence à dépasser le point où ils se trouvaient. Cela leur a permis en tout cas de garder une certaine sensibilité, sensibilité qui a toujours été l’élément moteur et la force d’attraction de l’oeuvre plastique, permettant tantôt un réconfort, tantôt un malaise, et donc une communication. Ce sont des œuvres qui, en raison de leurs propriétés émollientes, ne laissent pas le spectateur seul avec lui-même. L’art ne serait-il au bout du compte qu’un moyen parmi d’autres de sortir de la solitude ?
N.B. – J’aime le fait qu’une œuvre puisse raconter une histoire, qu’il y ait une interaction entre le spectateur et l’œuvre, qu’il y ait en quelque sorte un « produit » de cette interaction. De telles œuvres me touchent. Faire partie d’un autre monde pendant un instant… J’espère que ce que je fais permet cela parfois. J’aime l’idée qu’il y ait là une expérience très privée, totalement hors du contrôle de l’artiste. Ce que j’apprécie aussi chez ces artistes et dans leur œuvre, c’est la possibilité de multiples lectures, de nouvelles découvertes à chaque nouveau visionnement… mais aussi leur force visuelle… la recherche d’une forme d’absolu « visuel » chacun dans leur propre univers (Twombly et Opie, par exemple, dont on voit mal ce qu’ils pourraient bien faire dans la même phrase). À y repenser, ces artistes ont aussi en commun l’épure visuelle. Tenter de réduire l’œuvre uniquement à ce qui est strictement nécessaire graphiquement… Je voudrais avoir cette sobriété.
F.R. – Par rapport à ce que vous peigniez il y deux ans en Suisse, on peut dire que votre manière d’approcher tant la couleur que la ligne a subi une révolution qui a chamboulé de fond en comble votre travail de plasticien. Quelle incidence votre séjour américain a-t-il eu sur vous ?
N.B. – L’impact a probablement eu lieu à plusieurs niveaux. Les premiers mois ont été une période d’isolement assez éprouvante (adaptation, difficultés de communication, etc.). L’urgence de peindre était alors la plus forte. Avant tout, l’isolement signifiait que personne ne regardait vraiment ce que je faisais. Un sentiment de liberté un peu général s’en est suivi. Notre vie ressemblait beaucoup à une page blanche. Avec l’opportunité de nous réinventer. Cela, bien sûr, a eu un impact important sur la façon dont nous vivions. En Suisse, j’ai laissé un atelier de plus de cinquante mètres carrés, quatre mètres de plafond, un ancien local industriel. Boston, c’était un salon-cuisine et une chambre à coucher pour deux (avec deux chats). J’ai dû modifier mes habitudes (peindre à plat, séchage rapide, travailler plus proprement). Et puis il y a l’énergie US. L’imagerie américaine. New York et la présence beaucoup plus forte qu’à Lausanne de l’art contemporain, les musées, les galeries, etc. Et la chance encore d’avoir eu accès, par mon épouse, au monde de la musique et aux rencontres que nous avons pu y effectuer. Mon univers musical s’en est beaucoup élargi et, par extension, mon monde pictural (curieux que ça aille dans ce sens...).
F.R. – Les premiers peintres de l’abstraction étaient eux aussi proches du monde de la musique qui avait dans leur conception la valeur d’une remontée aux origines. Il y a presque toujours dans l’oeuvre non figurative une sorte de dilatation, une immédiateté, une amplification lancinante de l’être qu’elle rejoint dans l’ici et maintenant…
N.B. – Oui. Une peinture, c’est un bout d’univers. Et l’univers tient mal sur la table du salon. J’aime que la toile soit plus grande que moi. Le rapport physique est alors complètement changé. Avec certaines toiles faites à Boston, et qui couvraient grosso modo la surface que nous avions de disponible au sol, c’était véritablement être dans la toile. Peindre une partie de la toile tout en étant assis dessus... Pas d’espace pour être ailleurs que dedans...
F.R. – Le spectateur est lui aussi prisonnier de cet espace illimité de la toile : impossible de se soustraire à l’effet qu’elle produit. C’est un peu agaçant… On sent là une violence à peine contenue, un appel et, en même temps, parfois, une extrême fragilité, une douceur presque ; comment arrivez-vous à concilier de tels extrêmes ?
N.B. – Je ne sais pas... oui, il y a de la violence... probablement plutôt de l’urgence en fait... quelque chose comme le besoin de libérer le geste, de se laisser envahir... Je travaille souvent très vite. Il y a finalement passablement de déchets. Et chaque toile est un peu bâtie sur le fil du rasoir.
F.R. – Cette rapidité du geste est-elle une façon pour vous d’échapper à un certain côté consensuel ?
N.B. – Je n’ai pas l’impression de ne pas être consensuel. J’aimerais beaucoup être moins consensuel que ça ! Se libérer est si difficile...
Vous pouvez visionner des images sur le site officiel de Nicolas Bertholet
22:26 Publié dans Nicolas Bertholet, peintre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : peinture, art, art plastique, critique d'art

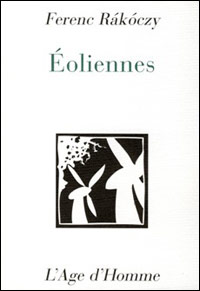
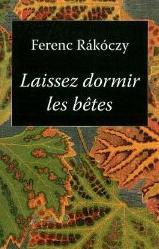





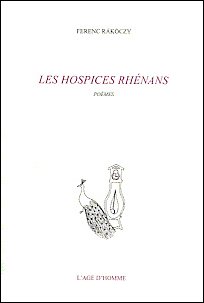
Commentaires
Super cool, cet interview!
Écrit par : Thifan | samedi, 09 juillet 2011
Entré par hasard dans la galerie Leplatenier alors que j'étais de passage au Flon, j'ai adoré la dernière expo de Bertholet. Je ne suis guère étonné que sa porduction vous plaise: c'est poétique, frais, plein d'énergie. Vraiment de la belle peinture.
Écrit par : Docteur B. | vendredi, 15 juillet 2011
Les commentaires sont fermés.