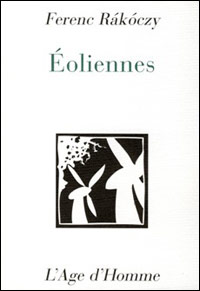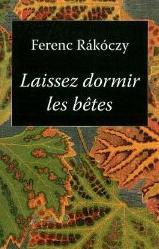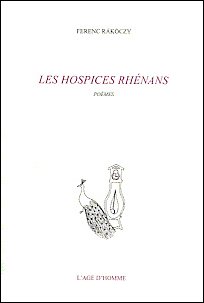samedi, 12 janvier 2013
Sagesse de l’arbre
Devant ma fenêtre il y a un arbre. Il est grand, vieux, complexe et en même temps d’une simplicité désarmante. Comme c’est l’hiver, on peut voir ses branches nues s’étager dans le ciel : la neige y prend appui. Lorsqu’il fait beau temps, un oiseau se pose près de la cime, où il demeure quelques instants avant de s’envoler à tire-d’aile dans l’éclat du jour. Mais c’est au plein de l’été que je le préfère, quand se déchaîne l’orage ; il évoque alors un paquebot appareillant au milieu des éclairs, cependant que ses membrures craquent sous les assauts du vent.
Son tronc est creusé à la base, comme déjeté, mais sa stature demeure imposante.
J’ai découpé, dans un journal d’« avant-guerre » déniché par hasard entre deux livres, une photo jaunie sur laquelle apparaît notre maison. Il s’y trouve, lui aussi, en plus modeste, en plus délicat, cela va de soi, mais c’est déjà la même noblesse. On reconnaît que c’est un platane. Sous la porte cochère, un groupe de gens en costume noir et au port droit, paysans revenus des champs, visages émaciés, marqués de rides, accompagnés d’un chien également noir qui dresse la queue devant l’œil de l’objectif. Des râteaux et des faux sont appuyés contre le fût déjà épais, et l’un d’eux tient un gros pain sous le bras.
Ce sont des hommes qui travaillent, même quand ils s’arrêtent côte à côte, l’instant où se déclenche le dispositif, avec cet air sérieux que produit une situation exceptionnelle; on sent que dans leur tête cela se continue – moins qu’un phénomène: une aspiration.
Ce sont des hommes qui savent encore ce que c’est que de fabriquer du pain, élever des murs… Il n’y a dans notre existence qu’une seule chose dont la gloire soit irréductible : c’est ce que nos mains ont bâti. Plus tard, ils se rendront dans le café le plus proche pour commenter cet instant, puis à la laiterie pour y apporter les boilles de la dernière traite. Et ils se coucheront entre des draps amidonnés, la conscience en paix.
Je suppose qu’ils ont tous, et depuis longtemps, tiré leur dernière révérence sur le monde. Ils sont plus loin, bien plus loin déjà, avec l’air qui pique les yeux, les flocons de neige qui chavirent dans le ciel. Les voici plus légers encore que sur la photographie, leur solidité s’est évaporée mais non pas leur rudesse.
Contrairement à l’arbre, qui recommence sa vie à chaque printemps, sans se dérober.
Si j’avais grandi dans les environs, sans doute aurait-il présidé à ma naissance. Toutefois, je ne suis pas d’ici. Je suis un transplanté, et mes racines, je n’ai jamais exactement su de quel côté les chercher. Et donc, je dois me contenter de guigner de son côté, rêvassant et me parlant à moi-même (mais c’est presque la même chose).
Est-ce une illusion ? Il se penche alors vers moi, ses frondaisons bruissent, c’est comme un chuchotis d’âmes. Le spectacle d’un poète à son bureau a quelque chose d’indiciblement triste. Je pense néanmoins qu’il se réjouit que je sois là. Je sens qu’il écoute, d’une certaine façon, même s’il ne répond pas. Sa sagesse renferme, secrets et contenus, une myriade de signes. Je pourrais le faire tronçonner (quel vilain mot), comme me l’a maintes fois conseillé le voisin, arguant du fait qu’il nous prend la lumière de l’après-midi. Qu’est-ce qui me retient ?
Mon vieux platane me rappelle celui que nous avions été obligés d’enlever, aux alentours de mes neuf ans, chez mes parents, parce que ses racines ruinaient les canalisations du quartier. Ma mère, qui tenait elle aussi beaucoup à son arbre – il avait peut-être pesé dans le choix d’habiter en cet endroit – a mis longtemps à s’en remettre. Oui, des années. C’était comme si on l’avait amputée d’une partie de son passé. Avant de prendre congé, nous étions montés de branche en branche, nous écorchant les mains, jusqu’au faîte, nous avions grimpé aussi vite que des singes, toute la petite bande enfantine pour l’occasion réunie.
Et nous avions poussé des cris stridents, comme on salue un guerrier emporté, debout, sur le champ de bataille. Cela avait été un jour mémorable, presque une consolation. Puis le bûcheron de la commune est venu et l’horizon, d’un seul coup, s’est dégagé. Je me souviens très bien de la mélancolie qui nous a habités les semaines qui suivirent.
Maintenant, bien sûr, un sentiment est un sentiment, il n’y a pas lieu de discuter là-dessus. Et il y a, certes, beaucoup de manières de faire face à ce qui nous blesse, se déchire et manque.
Alors, je regarde avec respect l’arbre plusieurs fois centenaire qui me fait signe lorsque je suis à ma table de travail. Son écorce se fissure par endroits, dégageant des écailles jaunâtres qui laissent apparaître le liège. Je ne sais pourquoi, ces irrégularités me paraissent très belles, très enseignantes. Car le temps est là, hors des souvenirs, pure sensation, qualité immédiate qui nécessite, pour ne pas complètement passer sous silence, que nous allions chercher au-delà des métaphores, là où la matière se désagrège, là où ça fait mal.
C’est un peu comme si ce monde et un autre se rencontraient à mi-chemin.
Que rajouter ?
Face à la grandeur silencieuse de l’arbre, face à son excessive netteté dans ce paysage de neige et de brouillards, l’homme pour ainsi dire n’existe pas. Sa main nous soulève toujours vers quelque chose qu’on ignorait. Il respire la nuit, comme nous.
La nuit tombe et l’univers s’ouvre comme un éventail.
L’arbre est suspendu entre deux infinis, celui de la terre, celui du ciel. Il plonge ses racines au cœur de la matière minérale. Il est à la hauteur d’un champ d’étoiles. Il est à la hauteur du cœur. Les initiés sauront certainement ce que cela signifie.
09:20 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (1)
samedi, 05 janvier 2013
Le bord des limbes, pièce en un acte pour deux personnages

Le bord des limbes, un conciliabule à deux voix, parle avant tout d’un phénomène psycho-corporel relativement rare et surtout très singulier : le déni de grossesse.
Entre 1995 et 1999, par un curieux concours de circonstances, j’ai été à plusieurs reprises en contact avec des mères présentant cette étrange problématique. J’étais alors un jeune interne pétri d’idéaux, mais force est d’avouer que ce qu’on m’avait inculqué jusque-là de connaissances médicales ne m’avait guère prémuni pour venir en aide à ces femmes. J’écoutais donc leur silence, j’essayais de percer les bribes de parole qu’elles ne semblaient jamais livrer pour leur propre compte mais par pure convention, et qui me heurtaient, moi, par leur éprouvante banalité, leurs lacunes, surtout par ce qu’elles avaient d’à la fois lourd et furtif.
On connaît bien la « normalité » de ces patientes, qui s’efforcent, contre toute attente, d’apparaître la plupart du temps aux yeux de leurs interlocuteurs comme des personnes quelconques, ordinaires et sans histoire. Plus on met à nu leur logique interne, ce mélange d’images fragmentées, d’impressions vagues, plus tout se brouille dans une informe succession de micro-propos privés de cohérence et pourtant présentés comme déterminants. Ce qu’elles ont a nous dire est si bien englué dans un bain de normalité qu’on finit soi-même par s’en trouver comme étranger au monde, en quelque sorte hors jeu et indéfiniment renvoyé à ses propres questionnements.
Curieusement, ce syndrome si mystérieux appelé déni de grossesse révèle aussi que déraison n’est pas forcément folie. Explorant les profondeurs de l’âme, le théâtre nous place alors au cœur de l’embolie du monde, des trous noirs de la nature humaine.
Car, dans son aspect de transe, le théâtre est le trafic d’influence du psychosomatique, l’accolade de la mémoire et de l’oubli. Chose insolite et terrible, il touche aux limites de l’être, il se pénètre de cette substance ligneuse du langage que les anciens déjà nommaient forêt. On joue sur les planches – ces arbres débités et néanmoins ressuscités dans leur sève à chaque spectacle – comme sous le couvert d’un feuillage très dense, sans savoir jamais de quel côté vont s’écouler la clarté et l’ombre. Artifices d’un rituel barbare, plein de force et aussi obscur que la plus touffue des sylves primitives.
Le plateau nous intéresse dans la mesure où il est capable d’absorber les forces vives de ceux qui l’approchent, de part et d’autre de la rampe, dans cette naissance en boucle où remontent au grand jour les rêves de chacun. Et c’est ainsi que notre rêve théâtral se consume lui aussi, mû par des causes exclusivement humaines, en un tourbillon qui ne saurait être ni coupable ni innocent, vers le haut et vers le bas. Surtout vers le bas. N’est-ce pas cela au fond la véritable énigme de chaque représentation ?
Le bord des limbes, Collection Théâtre Vivant, éditions l'Age d'Homme, 2012
11:35 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (0)